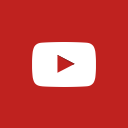Certain·es auront reconnu dans ce titre de table-ronde une célèbre citation d'un personnage de fiction... Mais au-delà de l'humour, les récits d'anticipation et de science-fiction envisagent régulièrement de faire table-rase d'une société malade pour reconstruire mieux. Alors, pourquoi pas ?
Enregistré le 20/04/2025 à l'occasion du festival L'Ouest Hurlant.
Tout cramer (pour repartir sur des bases saines?) - Avec Saul Pandelakis, Elio Possoz et Noëmie Lemos (Modération : Crystal Aslanian)