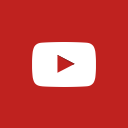Pour la première fois, La Ligue des auteurs pros et L'Observatoire de l'imaginaire seront réunis autour d'une question brûlante, qui touche l'écosystème littéraire de l'imaginaire francophone : fait-on face à une surproduction galopante qui nuit aux acteurices du milieu ?
Enregistré le 19/04/2025 à l'occasion du festival L'Ouest Hurlant.
Avec Stéphanie le Cam, Allan Dujiperou, Nicolas Marti, Fanny Valembois (Modération : Bénédicte Coudière)
Transcription :
Bénédicte Coudière. Bonjour à toustes ! Alors petit disclaimer avant de commencer nous sommes ici pour la table ronde : “la surproduction peut-elle éteindre l'imaginaire ?”. Je me permets de le préciser car il y a deux conférences au même moment, et qu'il y a eu sur les réseaux sociaux un petit échange des salles donc voilà ! Si vous n'êtes pas là pour ce sujet il y a aucun problème, on ne vous en veut pas mais sachez que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui ; c'est maintenant ou jamais pour quitter la salle, après oui, c'est bloqué vous êtes là et vous n'aurez pas le choix.
Bienvenue à toustes et merci d'être là ! Merci d'être là sur le festival et dans la salle puisque maintenant on a déterminé que vous étiez bien là pour ce sujet. Nous allons donc parler de “la surproduction littéraire peut-elle éteindre l'imaginaire ?” et avec moi, aujourd'hui, j'ai (on va commencer par là, comme ça on fait dans l'ordre des gens qui sont assis) : Nicolas Marti, tu es créateur et éditeur des éditions Sillex, une maison d'édition qui cherche à replacer l'auteurice au centre du modèle éditorial. Nous avons Fanny Valembois, tu es spécialiste des démarches de décarbonation des organisations culturelles. Pierre-Marie Soncarrieu qui es… fondateur d'ImaJn’ère ?, président, voilà (excusez-moi c'est la seule fiche que je n'ai pas), président du festival ImaJn’ère qui est à Angers, tu participes aussi à l'Observatoire de l'imaginaire. Nous avons aussi Stéphanie Le Cam : tu es maître de conférence en droit privé à l'Université Rennes 2, tu diriges l'Institut des Sciences Sociales du Travail de l'Ouest et la Ligue des auteurs professionnels. Et nous avons Allan Dujiperou qui est fondateur de Fantastinet, il y a plus de 20 ans maintenant quand même, et tu es aussi à l'initiative de l'Observatoire de l'imaginaire.
Le thème aujourd'hui est donc “la surproduction peut-elle éteindre l'imaginaire ?” et pour commencer ce sujet, d'où vient cette surproduction ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu’il y a moyen de la quantifier ? On va parler chiffres dans un premier temps, je pense.
Allan Dujiperou ?. Ah, il me laisse parler des chiffres [en parlant de Pierre-Marie].
La question de la surproduction, c'est une question qui touche tous les domaines et pas uniquement le domaine littéraire. Il faut se rattacher à des chiffres, et ça reste quelque chose qui est de l’ordre d’une perception de façon globale.
Au niveau de l'Observatoire de l'imaginaire, on observe les chiffres seulement autour de l'imaginaire et notamment ceux de la production. Ce qu’il est important de dire, c'est qu’en termes de chiffre d'affaires - parce que ça peut guider - le chiffre d'affaires est passé de 50 millions d'euros selon GFK en 2016 à 74 millions en 2023, ce qui veut dire qu'il y a quand même une progression assez importante du chiffre d'affaires, tout bêtement. Et en termes d'inédits adultes, on est passé·es de 900 en 2017 à 770 en 2023. Tout ça pour dire que déjà, on n'est pas forcément sur un emballement.
Il faut qu'on apporte une précision importante pour recontextualiser aussi : l'Observatoire de l'imaginaire s’appuie sur les modes d'édition classiques. Aujourd'hui, nous ne suivons que les éditeurices, dit·es traditionnel·les, donc les éditeurices à compte d'éditeurices, on ne travaille pas sur la partie auto-édition, sur la partie auteurice à compte d'auteurice ou participatif ou collaboratif, etc. Ce n'est pas par snobisme, je le précise, c'est juste que nous sommes toustes bénévoles et qu'à un moment, il faut qu'on arrive à suivre les choses, donc on s'appuie sur les bases de BDFI et nooSFere notamment. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. On peut le comparer aux chiffres qui ont été annoncés, dont on parlait tout à l'heure, en littérature globalement. Selon le SNE [Syndicat National de l’Édition], on a un passage de 111 503 parutions en 2022 à 104 304 en 2023. Donc aussi une tendance à la baisse de façon générale, mais qui doit être effectivement pondérée par rapport aux différents genres.
Bénédicte Coudière. Genres et types de publications.
Allan ?. Genres et types de publications effectivement. C'était le moment le plus boring. [rires]
Stéphanie Le Cam ?. Je prends la relève. Peut-être, pour remettre en perspective, parce que ce que tu dis est très juste : c'est que tu regardes la littérature de l'imaginaire et sur un temps relativement court. Si on dézoome un peu et qu'on regarde l'ensemble de la production éditoriale sur un temps plus long, c'est-à-dire depuis la fin de la seconde guerre mondiale, ce qu'on constate c'est quand même vraiment une explosion du nombre de références. On estime sur la base de données Électre qu'on a fait +50% du nombre de titres entre 2000 et 2023, 2000 étant déjà en très très forte augmentation si on le compare à 1950. Alors, évidemment, au milieu du XXe siècle, on n'était pas du tout dans une situation de surproduction éditoriale, donc il y avait un intérêt réel à augmenter le nombre de titres ; d'ailleurs ça a boosté la croissance aussi en termes de ventes, etc. Par contre, et je m'arrête là pour l'intro, mais ce qu'on observe depuis les années 2010 c'est qu'il y a un découplage, c'est-à-dire qu'on continue à faire plus de titres, par contre on ne vend pas plus d'exemplaires. La machine est en train de...
En tout cas, en général, évidemment, je ne parle pas de l'imaginaire.
MDR c ki même ? Allan Dujiperou ? OK je parie sur Allan. Ça veut dire, probablement, que comme on a un chiffre d'affaires qui continue à augmenter on a plus de ventes ; mais par contre, on est sur des volumes qui sont plus importants comme tu le disais, donc moins d'exemplaires par titre. Effectivement, nous on étudie sur la durée de vie de l'Observatoire, puisque c'est des chiffres qu'on peut suivre et donc sur lesquels on peut avoir une constance. Je voulais réagir au côté surproduction. Si on avait le même chiffre d'affaires pour une continuité d'augmentation, on pourrait parler de surproduction. Là, on a quand même... Les gens continuent à acheter un peu plus. Après, il y a tous les enjeux écologiques, etc. Et les revenus des auteurices qui rentrent derrière.
Nicolas Marti. Alors plus qu'une absence de surproduction, je pense que ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas d'emballement de la surproduction ou que l'emballement de la surproduction s'interrompt. Par contre, il y a une vraie discussion à avoir sur le fait qu'on est déjà dans une situation de surproduction, et ce depuis un bon 20, 30 ans. Et donc la question est un petit peu différente. Je suis d'accord que l'emballement, tous les chiffres le montrent, on est à -5%, je crois, sur la dernière année. -5%, à priori, c'est bien, ça veut dire que ça se calme. Mais en réalité, sur le global de ce qui est vendu et de ce qui est montré, sur la manière dont fonctionne, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, le système éditorial, la manière dont on essaie d'inonder les tables de libraires, etc. il y a déjà une logique de surproduction qui est en place, pour le coup, de manière très systémique et sans grande difficulté.
Pierre-Marie Soncarrieu ?. C'est là où l'Observatoire de l'imaginaire est extrêmement prudent avec le mot : pour parler de surproduction, il faut que la production arrive à saturation d'un élément quantitatif. Or, pour l'instant, du point de vue de l'imaginaire, ce n'est pas le cas, le chiffre d'affaires n'est pas à saturation, il continue d'augmenter. Les maisons d'édition continuent à accepter, et donc continuent à produire, et les ressources nécessaires à ça, on peut en discuter, sont encore suffisantes. Ce qui veut dire que, du point de vue purement factuel de l'Observatoire de l'imaginaire, basé sur les chiffres, la surproduction n'existe pas. Après, il y a plusieurs biais qu'on a évoqués, qui sont la partie pour les libraires, quelle est la place disponible pour la vie de la nouveauté ? Il y a aussi le biais de “est-ce que cette production est suffisante pour permettre la vie d'un·e auteurice” ? Ce qui est compliqué à gérer. Ou alors la partie sur les auto-éditions, les micro-éditions, les éditeurices à compte d'auteurices qui sont des chiffres qui n'entrent pas dans nos chiffres.
Donc toute cette partie là, qui est hors de notre spectre, pourrait arriver à la surproduction. Cependant, et c'est là le point de départ de l'Observatoire de l'imaginaire, d'un point de vue purement factuel, chiffré, accessible à toustes, la surproduction n'existe pas.
Bénédicte. Alors c'est bien, ça me laisse une ouverture très factuelle sur la crise du papier d’il y a quelques années, qui a entraîné justement des problématiques liées à la production de livres de façon générale - et pas qu'en imaginaire, et, du coup, à l'impact écologique que peut avoir ce type d'industries qui est l'industrie du livre.
Fanny Valembois. Peut-être juste rappeler que ce n'est pas parce qu'on parle à la fois de surproduction, d'impact écologique, etc., que c'est forcément d’un point de vue moralisateur. On parle de données, de données physiques, de données économiques, etc. et on n'est pas méchant·e ou mauvais·e par essence parce qu'on a publié un titre, ou au contraire qu'on n'a pas publié. Donc voilà, juste dire, c'est des sujets qui sont complexes, on va essayer de les aborder avec un peu de nuances.
Je trouve intéressant ce que tu viens de dire sur le fait que le marché n'est pas saturé aujourd'hui, parce que c'est sans doute vrai, moi je ne connais pas bien le marché de l'imaginaire. Par contre, on peut observer ce qui se passe dans les autres segments éditoriaux, où le marché est saturé. Et avant de parler des impacts écologiques, on peut peut-être déjà regarder ce que ça veut dire en termes d'impact ne serait-ce qu'économique. Je ferais la passe à ma camarade Stéphanie juste après, mais ce que tu disais dans les autres segments, ce qu'on observe, c'est effectivement que le marché n'a pas su corriger. C'est-à-dire que pendant 60 ans, la manière de fabriquer de la croissance, c'était de faire plus de titres. Ça a très bien fonctionné. Les éditeurices ne sont pas des gens idiot·es, ils ne font pas de la surproduction parce qu'iels sont bêtes, iels font de la surproduction parce que pendant 60 ans, ça a façonné le marché, et qu'à chaque fois qu'iels sortaient un nouveau titre, iels créaient de la croissance.
Ce qu'on observe depuis 2010, c'est que ça ne marche plus, en tout cas pour la littérature générale, on va dire, et les sciences humaines, et que ce qui se passe maintenant c’est qu’à chaque fois qu'on fait un nouveau titre, ça baisse le tirage moyen. Et ça le baisse de manière très très spectaculaire parce que, dans les années 80, on était à 14 000 exemplaires vendus par titre. Aujourd'hui, on parle des tirages, on n'a plus les chiffres de vente moyens, on est à 4 700. Donc on a divisé par 3 le nombre d'exemplaires, dans les versions optimistes, vendues et, ce qui est directement connecté à ça, c'est la rémunération des auteurs et des autrices. Donc ça c'est quand même le premier point. Je ne dis pas que c'est ce que fait la littérature de l'imaginaire, je dis que : attention à ce moment où le marché va être saturé et où c'est important d'avoir imaginé et pour être capable de changer, il faut être capable aujourd'hui de se dire : comment j'arrive à faire de la croissance - si la croissance est mon objectif - autrement que par les volumes. Et c'est tout le problème de la filière aujourd'hui, c'est que l'industrie du livre, elle ne sait fabriquer de la valeur économique qu'en vendant un objet neuf. Et donc elle est dans un système industriel qui doit fabriquer des objets et les vendre neufs parce que sinon elle ne crée pas de valeur. Et tant qu'on n'aura pas trouvé une alternative à ça et qu'on n'arrivera pas à réimaginer des manières de créer de la valeur pour l'ensemble de la filière, on aura cette tentation de fabriquer plus d'objets. Voilà, je n'ai peut-être pas trop envie de monopoliser la parole, je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce sujet là. Et je pourrais revenir après sur les autres sujets.
Stéphanie Le Cam. Moi, c'est vrai que je vais plutôt intervenir sur l'aspect rémunération des auteurs et autrices. C'est-à-dire que pour prolonger un tout petit peu et tirer le fil de la rémunération. (Je rapproche le micro, vous m'entendez.) Et bien, on a quand même noté une baisse colossale, entre 20 et 25% de rémunération depuis 25 ans maintenant de la rémunération des auteurs et autrices en lien avec le contrat d'édition. Évidemment, je ne parle pas d'auto-édition. Évidemment, je ne parle pas de toutes les activités connexes qui permettent encore de remplir le frigo. Mais très clairement, le premier retour qu'on a de nos membres, c'est qu'iels sont eux-mêmes contraint·es de multiplier les projets éditoriaux pour pouvoir s'assurer de vivre de leur activité d'auteurice toute l'année. Donc, ça veut dire que elleux-mêmes, et iels ne sont pas forcément très fièr·es de le dire, c'est assez tabou, mais elleux-mêmes participent en quelque sorte au mouvement de surproduction pour pouvoir rester en activité d'auteurice en sachant que c'est une activité extrêmement exigeante, qui demande une implication totale de son esprit, de sa force de travail, et que bien souvent, la pluriactivité vient ralentir le processus créatif, nous éloigne de notre public et donc, voilà, la surproduction devient à ce moment-là une sorte de solution de sortie pour rester en activité professionnelle.
Allan Dujiperou. Je pense que tout à l'heure, quand Pierre-Marie disait d'un point de vue factuel, il n'y a pas de surproduction, il ne fallait pas y voir une attaque. Le sujet était plus mécanique, de se dire qu’aujourd'hui, on a un certain nombre de parutions, on a un chiffre d'affaires qui continue à croître, donc, il y a une base de revenus, on va le dire comme ça, qui existe d'un point de vue éditeurice, auteurice, etc.
Effectivement, sur cette volumétrie-là (et c'est ce que tu précisais en disant qu'on a chuté par 3 le nombre de tirages), ça veut dire que mécaniquement, l'auteur, l'autrice, touche 3 fois moins. Je pense qu'il y a deux questions qui sont associées à ça, qui sont la surproduction et le risque écolo, etc., et je te rejoins sur le fait qu'il y a toute la projection et la multiplication qu’il y a eu depuis les années 50, et il y a la rémunération des auteurices. Nous, le point qu'on abordait simplement c'est “comment on définit cette surproduction ?” La surproduction, si on parle de surproduction par saturation du marché, ce n'est pas la vraie réponse aujourd'hui puisqu'on voit qu'il y a encore une marge de progression, et qu’il y a certains genres qui continuent de se déployer : on peut parler de la romantasy qui encore fait +117% entre 2023 et 2024. Et la question qu'il faut creuser maintenant c'est : comment on arrive à ce que les auteurs et autrices (et je pense que c'est ton combat et c'est le combat de nombreux éditeurices), peuvent vivre de leur plume avec ces contraintes-là ? Donc voilà je voulais juste re-situer la façon dont on avait répondu tout à l'heure, bien entendu on sait que pour les auteurs et autrices les revenus c'est quand même pas ouf, et qu'il y a énormément de travail à faire à côté. C'était simplement le fait de dire que si on regarde factuellement le nombre de parutions, on voit que ça baisse donc il y a un désemballement ; on va espérer que ça perdure un peu parce que c'est bien pour tout le monde. Et, le deuxième élément, qui est que, malgré tout : le chiffre d'affaires continue de progresser, de façon significative sur les littératures d'imaginaire, donc le marché n'est pas arrivé à saturation. Voilà c'était plutôt ça le propos.
Bénédicte Coudière. Justement ça m'intéressait de savoir ce que tu en pensais, Nicolas, sur ces questions de production, etc., toi qui a mis en place Sillex, qui vise, justement, à redonner un peu de place à l'auteurice.
Nicolas Marti. Moi, il y a deux observations. La première c'est qu'effectivement on parle de progression du chiffre d'affaires : alors c'est très vrai. Faut pas oublier que le chiffre d'affaires c'est une donnée qui n'intègre aucun coût en réalité. Or, les coûts ont explosé, et quand je dis explosé : pour vous rendre compte, nous, grosso modo, on vend nos ouvrages 25 euros, pendant très longtemps on faisait 25 euros frais de port inclus, parce qu'après tout pourquoi pas ? Aujourd'hui, si on fait ça, on va vraiment mettre la clé sous la porte dans l'heure en fait, ça n'est pas possible. On est sur une explosion des coûts de transports, entre 30 et 60% à peu près selon le transporteur que vous utilisez, le coût du papier à quasi-doublé, donc “les chiffres d'affaires augmentent” je pense qu'il y a une vraie adéquation à faire entre l'augmentation du chiffre d'affaires, telle qu'elle se présente, parce que les coûts des livres ont aussi augmenté. Si je prends vraiment strictement l'imaginaire, les ouvrages ont augmenté, en moyenne, de prix. Il y a quelques éditeurices qui font encore de la résistance et vraiment, c'est merveilleux, parce que j'adorerais pouvoir faire ça. Mais, d'une manière générale, on a tendance quand même à pousser un petit peu les prix, et les auteurices n’en bénéficient que très marginalement, on ne va pas se mentir. Et, d'autre part, sur ta question de comment est-ce que nous on gère ça : nous en général on publie un titre ou deux par an, et en fait là on arrive à saturation du modèle.
Pendant très longtemps on pouvait… Enfin, pendant très longtemps, non, pendant quatre ans, on s'est dit “OK, c'est jouable, on peut sortir un titre par an, le défendre à fond, essayer de faire en sorte que ça se passe bien”. Aujourd'hui, en fait, on est dans une situation très complexe où si on veut vraiment pouvoir maintenir le niveau de nos sorties il faudrait qu'on sorte, peut être, quatre voire cinq titres par an ; et je parle vraiment juste économiquement. Quelque part, moi, ça m'indique qu'il y a une logique derrière. Dernière observation, à propos de ce que tu disais : ça exclut l'auto-édition et je crois vraiment vraiment vraiment que la marge, comment dire, le volume de livres qui paraissent en auto-édition ne fait que croître. Pour le coup, tous les chiffres l'indiquent.
Pierre-Marie Soncarrieu. Alors je retire ma casquette “Observatoire de l'imaginaire” et je mets ma casquette “Comptable”, qui est mon vrai métier. [rires] Et tu as tout à fait raison : jusqu'à présent on parlait de chiffre d'affaires, chiffre d'affaires n'est pas bénéfices. Généralement, quand on parle d'augmentation du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que ça prend en compte l'inflation, c'est vous, dans la salle, public, qui est capable de mettre plus d'argent dans les achats de livres. Vous êtes capable d'acheter plus de livres sur une année. Cela ne veut pas forcément dire que vous êtes capables d'améliorer le niveau de vie des auteurices. Ni même des éditeurices. Ni même capables d'assurer une pérennité pour les maisons d'édition. Ça n'est absolument pas la donnée.
Sauf que, le prix de vente du livre, bah c’est le chiffre d'affaires. Et, fort heureusement en France encore, les marges et les bénéfices des maisons d'édition, ça fait partie du secret des affaires et on n'y a pas accès. Donc juste sur la partie prix de vente des livres oui on n'est pas à saturation puisque il est encore possible d'augmenter, par un effet mécanique de l'inflation. Mais est-ce que ça permet la viabilité de tout l'écosystème ? C'est une autre question sur laquelle l'Observatoire ne se prononcera pas.
Stéphanie Le Cam. On n'en a pas avec nous aujourd'hui mais je pense que ça serait vraiment intéressant de se demander aussi ce que ça représente, ces questions, du point de vue des libraires. On parle de marges économiques : il y a une étude qui est sortie l'an dernier au moment des rencontres nationales de la librairie, une étude xerfi qui disait, en gros, que dans les deux ans, vu les projections économiques actuelles, toutes les librairies indépendantes seront déficitaires. Les petites dès l'année dernière, les moyennes cette année, les grosses l'année prochaine. C'était les prévisions économiques.
Ce qu'on voit actuellement c'est effectivement une grande tension sur la librairie, notamment indépendante. Il y a eu une étude extrêmement intéressante qui a été publiée à ce moment-là sur la diversité commercialisée en librairie, et ça dit aussi quelque chose de l'impact de cette surproduction sur le métier de libraire. C’est une étude qui portait sur 400 librairies si je ne dis pas de bêtises - 424 librairies, qui ont été étudiées sur 7 ans. Iels ont pris toutes les données de vente, toutes les sorties de caisse sur 7 ans, sur 400 librairies. Donc ça fait 350 millions de références vendues. Et, ce qu'iels observent, c'est que pour un libraire, sur cette période, en moyenne - j'essaie de trouver mon chiffre - juste sur les romans, toutes catégories confondues, il a manipulé 320 000 titres différents. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente ? Et ça, c'est uniquement ce qu'il a pris en librairie. Ça exclut tout ce qu'il n'a pas pris en librairie. Dans ces 320 000, il y avait 37 000 nouveautés. Sur 7 ans. Imaginez.
On a tous cette expérience je pense, c’est une expérience qui touche les petites maisons que j'ai autour de moi, de dire que les libraires ne prennent pas mes livres. Il y a une association à laquelle je vous invite à adhérer, qui s'appelle l'association pour l'écologie du livre, qui a fait une petite étude qui dit, en moyenne, les jours d'office, c'est-à-dire les jours où les librairies reçoivent les nouveautés des éditeurs, on leur propose 313 titres chaque jour. Voilà, c'est ça la réalité d'un libraire aujourd'hui. Il y a 4 jours d'office par semaine. Donc, quatre fois par semaine, on leur propose 313 nouveautés. Est-ce que vous imaginez ? Est-ce que c'est possible, en fait, de lire ? Et de lire autre chose que les trucs mainstream hyper poussés par les gros distributeurs, par les grosses maisons d’édition qui ont des moyens, qui garantissent, etc. ? En fait, là, on commence à toucher à : je tue toute capacité d'intégrer de la diversité, de la petite maison d'édition, etc.
Fanny Valembois. Avec une baisse de lectorat en plus, ce qui est une vraie question, aussi, qui doit être prise au sérieux par toustes les acteurices de la chaîne du livre.
Stéphanie Le Cam. Et si on veut faire la transition avec les sujets environnementaux, petit quizz : la nouveauté qui arrive en librairie (les librairies indépendantes disent “une nouveauté, elle reste maximum 40 jours chez nous, mise en avant, maximum, après, elle repart”), sur cette nouveauté, en 4 à 12 mois, quelle part des livres qui arrivent en librairie, à votre avis, est renvoyée ? Je vais vous le dire tout de suite : c'est 62 %.
Et là, on touche à la fois à l'inefficacité économique de ce système et, évidemment, aux enjeux écologiques puisque non seulement on fabrique des livres qu'on va transporter, pour les retransporter, mais vous savez sans doute qu'une grande partie de ces livres va être pilonnée, donc détruite, pour faire des boîtes à oeufs.
Allan Dujiperou (presque sûr·e que c’est lui). Pour compléter ce que tu dis, ça a aussi une conséquence directe sur les éditeurices, parce que quand iels sont face aux taux de retour, iels découvrent, après coup, le clash économique. Et on a quelques éditeurices en imaginaire qui l'ont vécu un peu douloureusement ces dernières années. Donc voilà, on ne les citera pas, il y en a beaucoup qui les connaissent.
Fanny Valembois ? Et les auteurices aussi en pâtissent puisque, maintenant, on prévoit dans leur contrat d'édition des provisions sur retours ; c'est-à-dire qu'iels ne touchent pas la rémunération qu'on leur doit parce qu'on va anticiper ces retours. C'est de l'ordre de 30 %, sur plusieurs années. Donc en fait, personne n'y gagne j'ai l'impression.
Nicolas Marti. Je ne dirais pas “personne” [rires]. Je dirais qu'il y a quelques maisons d'édition qui organisent, d'une manière générale, cette saturation - alors “saturation” n’étant pas le bon mot dans ce contexte, je retiens la leçon - mais si vous dites que les nouveautés restent 40 jours maximum sur la table, imaginez : vous êtes une grosse maison d'édition, une très grosse structure, vous pouvez sortir, je vais vous dire n'importe quoi, 30 titres par mois et bien c'est merveilleux, vous avez tout le temps des ouvrages disponibles, toute l'année ; vous êtes une petite maison, vous sortez un titre et bien vous avez un créneau de 40 jours, donc vous avez intérêt à le faire fructifier, si vous l'avez bien entendu, si vous l'avez ! Donc effectivement il y a des maisons d'édition qui profitent et bénéficient de ça. C'est des maisons d'édition avec des beaucoup plus grosses structures, qui ont la possibilité d'entretenir ce qu'on appelle un tapis éditorial, un tissu éditorial, sur l'année complète.
Allan ou Pierre-Marie ? Je dirai Allan ?. Pour compléter ce que tu dis, et là on va rentrer aussi dans des chiffres qu'on a au niveau de l'Observatoire, on parle beaucoup du livre, de la chaîne du livre, etc., mais il y a aussi toute la chaîne presse. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 15% des livres vendus qui sont des livres d'imaginaire, par contre l'écho presse des titres d'imaginaire, dans la presse généraliste (je ne parle pas de la presse spécialisée) (vous verrez, c’est Muriel, à l'Observatoire, qui traite ce sujet-là), ça représente 4% des articles. Et à part quand il y a des cas comme Alain Damasio, on a quelques exceptions comme ça qui arrivent à surfer, à dépasser et à faire exploser les chiffres, mais sinon on est généralement sur des auteurs et des autrices mortes. En plus de ça, il y a une perte liée à la presse : on va se concentrer dessus. On a aussi des chiffres, de mémoire [ces grosses maisons d’éditions] c'est 60% des articles dans la presse généraliste : donc sur ces 4% [d’articles sur l’imaginaire], il y en a 60% qui sont sur des gros·ses éditeurices et pas sur des éditeurices spécialisé·es.
Donc voilà, tous ces éléments-là, c'est aussi la visibilité que peuvent avoir les littératures d'imaginaire sur le territoire et dans la presse généraliste. On va parler beaucoup plus facilement de l'anomalie, qui reste de l'imaginaire, mais chez un·e éditeurice mainstream plutôt que de quelqu'un·e d'autre. Et ça influe aussi sur les revenus, indirectement, puisque on perd cette visibilité : on perd la visibilité en librairie, on perd la visibilité en presse généraliste. Oui, on a des blogueur·euses, etc., qui font de la pub mais on reste à la marge sur nos activités.
Pierre-Marie ?. Sans parler de couverture médiatique, on parle de saturation du marché dans les libraires. Il ne faut pas oublier que l'énorme majorité des nouveautés, c'est pas forcément des inédits. Il y a beaucoup de fonds qui sont réédités. Je crois que l'année dernière, pour Dune, à l'occasion du deuxième film, il y avait six nouveaux livres sur le texte qui sont sortis quasiment en même temps. Ça fait partie de l'écosystème et ça amène donc à cette saturation puisque, au final, on ne rémunérera pas un·e auteurice qui est mort·e. Il y a toujours des droits pour les ayant-droits, mais qui sont beaucoup moins importants. Alors que les auteurices qui sont vivant·es, c’est elleux qui ont besoin de manger.
Stéphanie ?. Je suis évidemment complètement d'accord. Je rajouterai (je ne connais pas la littérature de l'imaginaire mais, en tout cas, en fiction classique) qu’il y a des livres qui ne sont pas des rééditions, c'est-à-dire qui sont des inédits, qui cependant sont des copies de trucs qui existent déjà. Ça existe, et c'est particulièrement visible dans les livres pratiques. Le 42e livre sur la cuisine à la plancha, le zéro déchet en famille, les machins comme ça, l’écoféminisme. Les libraires elleux-mêmes disent qu'iels n’en peuvent plus de cette littérature de reproduction. On l'a aussi beaucoup dans la littérature de jeunesse : le 42ème Petit Ours brun va au pot, etc.
Je ne sais pas dans quelle mesure ça existe ou non dans la littérature de l'imaginaire, ce phénomène de : “tiens il y a un truc qui marche, il y a un filon et on va y aller, on va en faire 50”. Moi ça m'arrive quand même assez régulièrement de lire un truc en me disant que j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça quelque part.
Fanny ?. Pour compléter, et dans le prolongement de ce que tu viens de dire, la problématique de la mutualisation. C'est-à-dire que les petites maisons d’édition et les auteurices ont le même problème. Iels vont compter sur un titre, deux, allez peut-être trois, pour générer une rémunération suffisante pour subvenir aux besoins de la vie. Versus des grosses maisons d'édition qui vont compter sur le fameux : “je mets dix cannes à pêches, il y en a une qui va mordre et ça va permettre de rentabiliser les neuf autres”. C'est justement ce rapport à la mutualisation qu'il faut questionner. Il y a des règles.
Bénédicte. Oui parce que bon, lancer dix cannes à pêches c'est bien, mais au final il y a quand même dix auteurices.
Fanny ?. Exactement, oui c'est ça.
Nicolas. Et surtout on se rend compte, quand on est dans les coulisses et qu'on commence à discuter, que quand iels lancent dix cannes à pêche, iels savent lesquelles des neufs ne vont pas prendre. La réalité c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation où, et je vais dire les termes, les primo-auteurices (donc pour les premiers romans), à moins d'avoir vraiment énormément de chance, parce qu'à ce stade on peut parler de chance
Bénédicte. Ou une communauté.
Nicolas. Ou une communauté. Mais du coup, si on a une communauté, on se tourne moins vers l'édition traditionnelle parce qu'il n'y en a pas besoin finalement. Ou qu'on peut s'adjoindre les services d'un·e éditeurice de manière plus indé, ou plus... Bref.
Donc les éditeurices, quand iels ont dix auteurices, iels ont neuf premiers romans et iels ont un... (Bon alors je vais pas prendre Damasio car c'est un mauvais exemple parce qu'on est pas dans le bon milieu, mais en littérature générale on va être sur un Hervé Le Corre par exemple, ce serait très bien.) On va un peu sacrifier les neufs sur l’autel des besoins : de préparer le terrain, d'avoir un maximum de disponibilité, et de visibilité. C'est très injuste mais ça s'oppose aussi à une discussion qui n'est pas inintéressante sur “si on dit qu'on réduit la production, est-ce qu'en réalité on va pas se concentrer sur des gens qui sont déjà déjà édités ?
Fanny ou Stéphanie ?. Après il y a la question du contrat, et sans vouloir faire un cours de droit (on n'est pas là pour ça), les dix [auteurices] vont vendre toute leur propriété intellectuelle, pour toute la durée de la propriété intellectuelle, pour toutes les exploitations possibles et imaginables et même inenvisagées encore actuellement, à un·e éditeurice qui n'en fera pas grand chose. Donc ça intéresse aussi les juristes parce qu'on se retrouve avec des auteurices qui sont complètement dépouillé·es de leurs droits de propriété intellectuelle pour une exploitation qui va durer 2 semaines quoi. Et effectivement, c'est là où on voit bien qu'il y a un problème d'équilibre des contrats et on essaye, nous, depuis 5 ans, d'obtenir un rééquilibrage. Et alors, attention, est-ce qu'on y parvient ? Non. [rires]
On n'a rien, on n'a aucune espèce de sortie positive. Le ministère de la Culture botte en touche systématiquement parce que, selon lui, les partis qui sont invités à la table des concertations collectives pour améliorer le statut des auteurices ne se mettent pas d'accord. Donc, en fait, il attend qu'on trouve une solution. Si vous avez des solutions, je les prends.
Stéphanie ou Fanny ? L’autre en fait. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais. Je pense que c'est en partie juste quand tu dis que quand on en fait dix, en réalité, on sait un peu ce qui marche. Et en même temps je crois que (même si on sait que je ne suis pas là pour défendre les grands groupes) si vraiment, ils savaient ce qui marche, ils arrêteraient très probablement de faire ce qui ne marche pas.
Nicolas. Je suis entièrement d'accord, et c'est pour ça que je parlais de chance tout à l'heure. Vraiment, j'ai littéralement assisté à des conversations qui vont dans le sens de ce que je vous indique. [nom d’une maison d’édition censurée au montage], en fait, je vais être direct.
Fanny ou Stéphanie ?. Ce sera coupé au montage. [rires]
Nicolas. [rires] Oui, ce sera coupé au montage. Mais où grosso modo, la discussion, c'était, je cite : “non, mais ça, si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave, ce n'est pas là pour ça”. L'expression, c'était ça : “si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave, ce n'est pas là pour ça.”
Allan ou Pierre-Marie ?. Malgré tout, la tournure de la phrase dit : “si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave”, ça ne dit pas : “on sait que ça ne marchera pas”.
Bénédicte. Oui, c'est aussi dire : sur un malentendu, ça passe. Enfin, c'est pareil.
Fanny ?. Et ça va prendre la place d'un livre concurrent, et c'est sa fonction aussi. Ça participe à l'invisibilisation du travail éditorial d'une autre maison d'édition qui va faire son travail proprement et vertueusement. Et c'est là où, justement, c'est une économie de la visibilité.
Stéphanie ?. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi autre chose qui se joue. Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment chez les gros·ses [maisons d’édition], quand on commence à leur dire : “bon peut-être qu'il va falloir arrêter de faire 50 000 titres différents par an” et qui répondent immédiatement : “mais, enfin, vous n'y pensez pas, si on fait moins de titres on va tuer la bibliodiversité, la diversité, la création, machin”. Moi je trouve intéressant de dire que oui, on est d'accord pour tuer les créateurs et les créatrices, c'est-à-dire de pas les rémunérer, de pas les payer, mais par contre il faut protéger la création ; c'est intéressant quand même comme paradoxe.
Pierre-Marie ?. Ça fait écho à une table ronde qui a eu lieu l’année dernière, qui était celle sur les agents littéraires, ici [à l’Ouest Hurlant en 2024], et il y a cette question, en tout cas en France - c'est un avis que j'ai à titre personnel - le statut d'auteurice c'est un petit peu un miracle. Tout le monde a envie d'être auteurice et c'est un métier-passion. C'est pas grave si tu n’en vis pas, parce que quelqu'un d'autre viendra prendre ta place, parce que, ellui aussi, iel aura envie d'être auteurice.
Fanny ?. J'ai mille choses à dire [rires] En fait le problème c'est qu'on a cette logique romantique qui a la peau dure, celle que tu pointes, là, où d'un seul coup on est le génie au service de l'élévation du fond commun de la connaissance, et on va s'investir dans cette vocation qui est de créer, bon. Alors, oui, il y a sans doute des auteurs qui sont en robe de chambre dans leur appartement haussmannien, qui attendent l'inspiration le matin et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. Nous, on a quand même dans nos membres des professionnel·les qui sont investi·es dans des contrats, qui font des interventions en milieu scolaire, qui font des ateliers, qui font des résidences, qui ont cette posture professionnelle et qui ne sont pas payé·es. [Des gens] à qui on fait des commandes littéraires, à qui on demande de réaliser un travail vraiment peaufiné, qui mettent tout leur professionnalisme et qui ne sont pas payé·es pour leur travail de création. Donc vous voyez, il y a ça aussi. C'est vrai, tout le monde a envie d'être auteurice, - d’ailleurs, je crois pas en fait - et en même temps on s'est mis en tête que c'était pas un métier, alors que si, c'est un vrai travail de créer.
Bénédicte. Et il y a aussi cette posture : “puisque c'est passionnant, puisque c'est un métier passion, vous n'allez pas demander de l'argent pour faire ça quand même !”
Fanny ?. Oui, “il serait pas question, en plus, qu'on vous paye !”
Bénédicte. Il y a cette posture, presque romantique, là, de dire : “mais tu vas pas salir ta passion avec de l'argent quoi”.
Fanny ?. Ouais, enfin les éditeurices je pense que ça doit être passionnant leur métier, les libraires ça doit être passionnant aussi, celui qui transporte le livre d'un point A à un point B c'est passionnant aussi, et pourtant, tout le monde est payé sauf l'auteurice. [rires]
Allan ?. J'ai une petite question ouverte : aujourd'hui avec la multiplication des moyens de publier, je pense aux assez grands vecteurs d'écologie que sont Amazon et autres - évidemment, c'était du second degré, je précise quand même - aujourd'hui n'importe qui - je suis volontairement provocateur - ça donne l'impression que n'importe qui peut être publié, édité, et en fait que tout le monde peut le faire. Je pense à, et là on revient vraiment sur la chaîne du livre, tout ce qu'il faut faire pour protéger chacun·e des acteurices de la chaîne du livre. Aujourd'hui, ces éléments-là tendent à l'invisibilisation des professionnel·les, des auteurices professionnel·les, etc.
Pierre-Marie ?. Mais de la même manière qu'on parlait de commandes, ou du fait d'écrire toujours plus de manière à pouvoir en vivre un petit peu, c'est pas nouveau. Je pense notamment à Moorcock qui me vient en tête, qui disait qu'un livre sur deux, c'était de l'alimentaire. Lui il faisait un livre sur deux, c'est-à-dire un livre tous les deux ans. Et on n'en est pas à plusieurs livres par année. On arrive à une ubérisation du métier de l'auteurice où le but n'est pas d'écrire un roman mais de pondre une suite de textes. C'est pas très loin de Chat GPT.
Stéphanie ?. Exactement. Et justement, on n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle.
Bénédicte. C'était ma prochaine question.
Stépahnie ?. C'est évidemment une crainte ! C'est évidemment une crainte, je veux dire, on a déjà des problèmes de visibilité du travail de création. Comme [l’I.A.] ne coûte rien, c'est facile de commander plein de textes, et puis ensuite de voir si on produit ou pas. Et puis Chat GPT. Et là qu’on se dit : “OK, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi, l'étape d'après ?”.
Je crois qu'Amazon a limité à 3, par auteur et par jour, le nombre de dépôts de manuscrits. Bon, moi je ne sais pas qui écrit à cette vitesse, mais 3 romans par jour c'est quand même fascinant.
Nicolas. Après Petit ours-brun, on en a parlé, ça doit être jouable [rire] ça doit être jouable ! [rires]
Bénédicte. Il faut les illustrer par contre !
Nicolas. Sans les illus ! [rires]
Stéphanie ?. Ce qui me fait peur avec l'intelligence artificielle c'est que, finalement, ça risque de pousser à son paroxysme deux effets qu'on a déjà nous dans le secteur du livre, à savoir : précarisation des auteurices et invisibilisation des titres (parce qu'ils ne sont pas assez exploités et ne permettent pas de produire suffisamment de revenus pour l'auteurice). Avec l'I.A., l'invisibilisation va être encore plus importante et puis la surproduction, ou plutôt l'apparition de contenus synthétiques qui viendront invisibiliser le travail humain.
Bénédicte. Et le vol des données.
Nicolas. Oui, sans parler de la propriété intellectuelle, on est bien d'accord.
On va changer de sujet, mais pour revenir rapidement sur ce qu’on disait sur la professionnalisation et la manière dont on traitait les auteurices de manière non professionnelle. Je trouve que, particulièrement en imaginaire, hot take, absolue hot take, on a tendance à effacer les limites de ce qui est du professionnel et du non-professionnel. On parle d'un milieu dans lequel on signe des contrats dans des bars [rires]. C'est un problème, je vais être très clair c'est un problème.
Bénédicte. Ou on entend des “t'inquiètes”. Quand tu dois signer le contrat “t'inquiètes”.
Nicolas. C'est ça ! Vraiment, je pense qu'il faut se rendre compte aussi que l'imaginaire, comme c'est d'abord et avant tout cette notion de littérature-passion, d’ailleurs encore plus dans l'imaginaire, on va se dire que, c'est vrai, on peut abolir toutes les limites du professionnalisme, on peut discuter comme ça au coin d'une table, on peut signer des contrats bourré·es, … Mais non, enfin, merde.
Stéphanie ou Fanny ?. Ça c'est hyper intéressant.
Allan ou Pierre-Marie?. Oui, enfin ici on est parfois aussi sur du vécu ; j'ai pas de souci avec ça mais, sur ces éléments-là précisément, il faudrait être très factuel, comparer les contrats qui sont proposés par les éditeurices d'imaginaire et les autres. Je ne remets pas en cause [les propos tenus], je dis qu’ils demandent à être confirmés : par exemple, savoir si les taux de paiement des auteurices sont plus ou moins importants au niveau de l'imaginaire versus les autres.
Nicolas. C'est moins sur la teneur des contrats que sur la manière dont on abolit le côté professionnel. C'est plutôt ça.
Allan ou Pierre-Marie ?. D’accord, d’accord. Parce que si dans le même temps on le trinque au bar et que l'auteurice touche deux points de plus que ce qu'iel aurait touché chez une maison d’édition mainstream, c’est peut-être pas si grave. Tant que l'éditeurice est plus bourré·e que l'auteurice, ça marche. [rires]
Stéphanie. Alors, justement, pour prendre un peu de hauteur, nous, à la Ligue des Auteurices Professionnel·les, on a une permanence juridique. On reçoit pratiquement 400 demandes de consultations juridiques par an, pour vous dire, dans tous les secteurs confondus. À la question de savoir si les contrats sont anormalement ou principalement déséquilibrés dans le domaine de l'imaginaire, la réponse est : c'est des contrats-type. Des contrats qu'on retrouve dans tous les secteurs. Et en fait ils sont globalement déséquilibrés oui, puisque c'est des cessions, globalement pour toute la durée de la propriété intellectuelle, contre des taux qui sont globalement de 7%, en moyenne, pour les auteurices, avec des durées d'exploitation qui ne correspondent pas à la durée de cession des droits.
Bénédicte. Et avec des clauses qui peuvent être abusives, sur lesquelles on peut négocier derrière, mais qui sont mises de base à l'intérieur des contrats.
Stéphanie. Des packs de préférence, des levées d'options, des petites choses très sympathiques qui peuvent même menacer la sécurité juridique des auteurices.
Bénédicte. Est ce que je peux juste demander de préciser pour le public ce que que signifie ces termes-là ?
Stéphanie. Alors “packs de préférence” : vous signez votre premier ouvrage avec un·e éditeurice qui va éventuellement vouloir vous avoir pour les autres ouvrages. Donc iel va vous demander de lui garantir, en quelque sorte, une forme de priorité, soit pour cinq ouvrages, soit pour cinq ans ; ça dépend du secteur d'activité. Et généralement, quand vous signez, ça veut dire que les autres contrats seront à l'identique du premier pour les cinq prochains ouvrages ou les cinq prochaines années. Ce qui a tendance quand même à maintenir l'auteurice dans une relation contractuelle qui n'est pas forcément satisfaisante. Et pour ce qui concerne la levée d'options, alors ça c'est ma préférée en droit ; c'est pour vous dire : “je vous commande un ouvrage, mais je vais estimer si je prends le risque de le publier au moment où vous me remettrez l'ouvrage. Si je publie l'ouvrage, tout se passe bien ; si, en revanche, je décide de ne pas publier l'ouvrage, dans ma grande bonté, vous pourrez garder votre avance au titre de dédommagement. Mais il est évident que si vous publiez l'ouvrage chez une autre maison d’édition, vous me rembourserez cet argent que je vous ai avancé”. Donc les levées d'options c'est extrêmement casse-gueule, et il faut faire très attention quand on signe son contrat. Et si vous avez besoin d'une petite formation en droits d'auteurices, tout à l'heure, à 14h, on propose une petite masterclass. Je fais notre promotion. [rires]
Bénédicte. J'allais le dire, tu le fais mieux que moi. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Allan ou Pierre-Marie ?. Non non, ce que tu dis finalement c'est que dans le monde de l'imaginaire c’est ni plus, ni mieux qu'ailleurs, c'était plutôt ça que je voulais dire.
Stéphanie ?. Après il faudrait voir à effectivement aller chercher plus finement des résultats. Et peut-être que l'Observatoire pourrait justement, avec des partenaires, avec des acteurices comme les organisations professionnelles que nous sommes, aller un peu plus loin avec des contrats à l'étude. Il y a en tout cas, dans le domaine du livre, des relations pseudo-amicales qui font qu'en effet c'est compliqué de négocier son contrat. D'abord, vous prenez, en l'état, le contrat : souvent, en plus, on renvoie à l'idée que : “c'est le contrat standard, c'est le même contrat pour tout le monde, et ça vient du service juridique, et puis tu comprends moi je suis pas juriste” et ça, ça revient souvent.
Bénédicte. Et puis je pense que, Nicolas, tu pourras nous en parler mais il y a aussi un côté propre à la France : on ne parle pas d'argent.
Stéphanie. Ah oui, c’est tabou.
Bénédicte. Et, de ce fait, les auteurices ne vont pas forcément discuter de leurs contrats et notamment des pourcentages de vente avec d'autres auteurices, pour se rendre compte qu'il y a un déséquilibre.
Stéphanie. Moi je donne des formations à la négociation contractuelle. Généralement, après, les auteurices repartent boosté·es, et la première chose qu'iels font c'est d’appeler leur éditeurice pour leur dire : “ça va pas”. [rires] Bon je leur dis quand même : “calmez-vous”. Mais il y a vraiment cette idée que l' on ne peut pas négocier. C'est à prendre ou à laisser, c'est un contrat d'adhésion. Alors que non, on peut contre-proposer des choses, au risque de se prendre une porte mais tant pis.
Pierre-Marie ou Allan ?. Et ça rejoint, je reviens sur ma table ronde de l'année dernière, sur l'idée d’avoir des agent·es qui s'occupent d'auteurices, puisqu’iels ont accès à l'ensemble des chiffres de toustes les auteurices de leur pool. Et donc iels sont capables de négocier au plus juste, ça ne peut pas forcément dire bien, mais au plus juste selon ce qu'iels ont. Et, par contre, c'est aussi la raison pour laquelle en général les maisons d'édition, surtout les grosses, sont contre les agent·es parce qu'en face il y a des gens qui ont du répondant et qui vont à l'encontre des clauses abusives.
Stéphanie. L'agent·e est bien quand, effectivement, on se sent incapable de négocier soi-même, même si c'est pas très à la mode en France (alors qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas bosser si vous n’avez pas d'agent·e, c'est comme ça). Cela étant, moi je suis quand même assez militante, et je défends l'idée qu'on doit se professionnaliser. On doit être dans une posture professionnelle. Je compare parfois les auteurices aux plombièr·es. Moi, avec mon plombier, quand j'ai besoin d'avoir un devis, je veux dire, ça se fait pas au bar à 23 heures. Je lui dis pas : “non mais attends, fais-moi confiance, je vais t'inviter au baptême de mon fils”, parce qu'on a vu des relations pseudo-amicales pourrir la négociation du contrat. On est dans une posture professionnelle. Combien vaut mon travail ? Voilà. Personne n'est foutu d'identifier le prix de son travail, parce que c'est un gros mot, en fait, de parler d'argent. Alors qu'on y passe du temps, on s'est formé·es, on a fait des études, on a fait de la recherche, et tout ça, ça a une valeur. Et cette valeur, elle est complètement invisibilisée.
Allan ou Pierre-Marie ?. Mais ça aussi, ça rejoint le fait et le biais de : la plupart des auteurices ne sont pas des auteurices professionnel·les. Iels ont une autre vie professionnelle à côté. Et la plupart, le moment où iels deviennent auteurices, c'est le Graal, donc on accepte pour pouvoir l'être.
Bénédicte. Mais c'est le serpent qui se mord la queue au final. Parce que le fait de pas pouvoir avoir de vraies rémunérations ou d'avoir une précarisation des auteurices fait qu'on est obligé·es d'avoir un travail à côté, fait qu'on n'est pas forcément au courant [de manière professionnelle] et on finit par se mordre la queue sur pas mal de trucs.
Nicolas. J'interviens en tant que maître de conférence à l'Enssib à Lyon qui est finalement une école d’éditeurices. Assez fréquemment quand j'interviens - donc moi, j'interviens sur la notion de propriété intellectuelle, et je suis leur seul cours de propriété intellectuelle donc iels m'ont, on va dire, huit heures au total dans l'année pour que je leur explique un petit peu ce que c'est que le droit d'auteur - et souvent iels le découvrent. Donc il y a un problème de professionnalisation des auteurices mais je pense que sur certaines petites structures éditoriales il pourrait être intéressant d'avoir une professionnalisation des éditeurices également.
Pierre-Marie. Dans l'association imaJn’ère, on fait des cycles de conférences universitaires chaque année. L'année dernière, c'était sur l’intelligence artificielle dont on pourra parler plus longuement et le premier biais qu'il y avait c'était la culture anglo-saxonne qui arrivait en France. En France, la plupart des gens, quand on parle droits d'auteurices, pense copyright. Ce qui n'a strictement rien à voir, de fait. Il y a donc des personnes qui se disent : “mais moi, mon livre, c'est un copyright sur mon truc”. Mais ça n'a rien à voir parce que le droit français est un peu invisibilisé par rapport à ce qu'on a l’habitude de voir. L'exactitude du droit, c'est vraiment une spécificité le droit de la propriété intellectuelle, c'est une spécificité française, je crois pas qu'elle existe ailleurs.
Bénédicte. Ah si.
Stéphanie. Si quand même. Il y a une convention de Berne qui a été mise en place pour défendre une base de droits d'auteurice au niveau international, après oui il y a des variantes. Nous, on a le droit d'auteurice à la française, qui a beaucoup influencé les différents états de l'Union européenne ; on a d'ailleurs une législation européenne qui maintenant organise un cadre européen pour la protection des auteurices. Et puis, effectivement, il y a le copyright américain mais qui a quand même des points de contact avec le droit d'auteurice.
Stéphanie ou Fanny ?. Puisque le sujet c'est cette question : “est-ce qu'on peut tuer les imaginaires”, un·e des acteurices de la chaîne dont on n'a pas parlé c'est les lecteurices et il faut se demander quel est l'effet de la surproduction, ou de l'absence de surproduction, ou en tout cas du modèle de production actuelle, sur les lecteurs et les lectrices. Est-ce qu'on est dans un système qui fabrique des livres, ou est-ce qu'on est dans un système qui fabrique des lecteurices et de la lecture? Je ne suis pas sûre qu'on mette énormément d'énergie aujourd'hui à fabriquer des lecteurs et des lectrices, ça m'intéresse du coup d'entendre comment on fait pour fabriquer des lecteurs et des lectrices. J'ai l'impression que c'est très pris en charge par l'école, par la bibliothèque, etc., qui sont des secteurs non-marchands, et moi je serai assez intéressée de savoir comment le secteur marchand inclut cette question-là, fabriquer de la lecture.
Nicolas. Il y avait les journées mondiales de l'écologie du livre qui se tenaient à Strasbourg, littéralement juste avant l’Ouest Hurlant. Et lors d'une conférence, je crois que c'est l'intervenant de “Recyclivre” qui a dit quelque chose que je trouvais très juste : en ce moment, il y a des interventions, notamment au salon du livre, sur le fait qu'on devrait instaurer un droit sur la vente du livre d'occasion, pour rémunérer mieux les auteurices. Mais peut-être qu'avant de se poser cette question là, il faudrait se poser la question de comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens lisent plus, tout simplement. Parce que c'est ça qui booste les ventes, en réalité, bien plus que de remettre en question le circuit d'occasion.
Allan. Je suis totalement en ligne avec ça. Comme tu le disais en plaisantant tout à l'heure, ça fait 25 ans que Fantastinet existe, ImaJn’ère existe aussi depuis un certain nombre d'années. Je pense que ces actions-là, aujourd’hui, ne peuvent venir que d’un tissu associatif. C'est-à-dire que l'école a atteint ses limites sur les sujets, sur les missions qu'on lui donne. Je pense qu'aujourd'hui, le seul moyen qu'on a, et c'est ce qu'on avait déjà dit lors des états généraux de l'imaginaire en 2017, c'est que les amateurices de littérature, et de littérature d'imaginaire en particulier, descendent dans l’arène, montent des clubs de lecture, organisent des rencontres avec les auteurices sur les différents secteurs. On crée des lecteurices parce qu'on crée de la passion. Et aujourd'hui, les collégien·nes, les étudiant·es et même les adultes n'ont pas les outils, n'ont pas forcément la connaissance, n'ont pas le réseau pour être conseillé·es. Nous, on a monté, avec l’asso Fantastinet, un club de lecture à l'université du Mans. On a eu 15 personnes qui n'étaient pas de l'université. C'est aussi un moyen de redonner goût à la lecture. Je ne pense pas qu'on arrivera simplement avec un travail éditorial, un travail de communication à le faire. Il faut que ceux qui aiment y aillent, en fait.
Pierre-Marie. C'est le Monde qui a publié une étude en disant que 2024, c'était la première année où le temps passé à la lecture était en baisse. Par rapport à avant ?
Stéphanie ou Fanny ?. Oui, c'est tous les ans, c'est un effondrement, la lecture.
Pierre-Marie. La France est quand même parmi les 10 premiers pays européens où il y a le plus de temps consacré à la lecture ; mais effectivement on a perdu quelques places. C'est le tissu associatif qui fonctionne, comme tu le dis. L'association imaJn'ère est en lien avec avec les universités, avec les bibliothèques. On monte des clubs mais la moyenne d'âge des personnes qui viennent ne va pas en rajeunissant.
Stéphanie ou Fanny ?. C'est 32% des jeunes de moins de 16 ans, qui lit tous les jours ou presque tous les jours. C'est 26 minutes par jour, en moyenne, par jeune. Enfin je veux dire 26 minutes quoi, le temps de concentration.
Nicolas. Et quand on fait la projection, si on se base sur les dernières années, en 2030 on ne lit plus du tout.
Stéphanie ou Fanny ?. Voilà c’est ça. On ne lit plus.
Stéphanie ou Fanny ?. Et ce qui était intéressant à voir dans cette étude, c'est qu’il y a un effondrement des populations plus âgées, qui étaient les populations qui résistaient, et - c'est sans doute moins vrai dans l'imaginaire, je ne sais pas - en tout cas, pour le vaisseau-amiral de l'édition qui est la fiction classique, clairement, les acheteurices sont en train de disparaître. Il y a celleux qui meurent, il y a celleux qui arrêtent de lire, et peut-être qu'à un moment, il va falloir que le secteur s'interroge sur comment on retrouve des lecteurices.
Pierre-Mallan ?. Rapidement : on a fait une étude de lectorat dans le cadre de l'observatoire de l'imaginaire, sur le lectorat d'imaginaire, c’est disponible en ligne. Allez découvrir quel type de lecteur ou de lectrice vous êtes !
Stéphanie. C'est intéressant, parce que - je vais retirer le fil du livre d'occasion - là, c'est très actuel : on a vu le SNE et le Conseil Permanent des Écrivains s'émouvoir devant le président Macron et devant la ministre Rachida Dati, sur l'idée que le livre d'occasion, c'était le mal incarné, qui allait empêcher aux éditeurices et aux auteurices de remplir le frigo. Bon, en tout cas, côté Ligue des Auteurices Professionnel·les, c'est absolument pas ce qu'on dit. Bon, si vous voulez vraiment vous en faire sur la capacité des auteurices à être rémunéré·es, intéressez-vous aux 90% du marché du livre neuf et au partage de la valeur, s'il se fait bien, là, à ce moment-là, peut-être un jour, on s'inquiètera du livre d'occasion. Au-delà de ça, face à la chute historique du nombre de lecteurices, à un moment donné, si les gens vont vers le livre d'occasion comme dernier moyen d’accéder à la lecture, on ne va pas, en plus, les taxer. Enfin, je veux dire, ça n'a pas du tout de sens. Donc, je crois que je suis ravie d'entendre à chaque fois Fanny redire que c'est des modèles économiques nouveaux qui va falloir inventer, imaginer. Et donc, je me réjouis par avance que, voilà, il y a des expériences qui sont lancées, on verra ce qu'elles donneront, mais...
Bénédicte. Alors, je suis entièrement d'accord. Cette table ronde est passionnante. [rires] On est d'accord. Il reste moins de 10 minutes, aussi, même si les échanges pourraient durer encore très longtemps, je vous propose qu'on prenne quelques petites questions du public.
Question 1. La question justement sur les livres d'occasion, puisque quand je vais acheter des bouquins sur un vide-grenier, j'ai l'occasion d'acheter un bouquin 5 balles par rapport à un bouquin que je vais payer 25 euros chez Leclerc ou chez un éditeur local. Honnêtement, je n'ai pas le budget pour mettre 30 balles ou 25 balles à chaque fois dans un bouquin. Et derrière, les 5 balles que je vais filer, je ne vais pas les filer à l'auteur. À la personne qui a écrit le livre, je ne sais même pas si ça peut être une intelligence artificielle, malheureusement. Donc c'est la difficulté de l'édition en occasion et aussi la question de l'édition numérique. Puisque j'ai des amis qui écrivent et mais qui n'éditent que sur Amazon parce que ça leur coûte rien mais ça leur permet d'être diffusé à petite échelle et je n'ai aucune idée des revenus que ça peut générer pour la personne qui écrit.
Fanny ou Stéphanie ?. En l'occurrence l'édition d'occasion ne génère aucune rémunération puisqu'il sort du schéma classique qui consiste à calculer le pourcentage sur le prix public hors taxes. Le livre d'occasion est revendu donc il n'y a plus de droits à rémunération sur livre d'occasion. Voilà, il n'y a pas de rémunération.
Bénédicte. Alors on va essayer de faire une question un homme, une femme, un homme, une femme pour que la parole soit le plus facilement diffusée.
Question 2. Bonjour merci à tous pour vos interventions alors moi ma question c'était, on n'a pas vraiment parlé de l'édition numérique et de justement, c'est à la fois un travail d'édition qui est peut-être un peu différent, un mode de consommation de lecture qui est différent aussi donc sur l'aspect de lire plus ou pourquoi est-ce qu'on lit moins et sur quel support, donc je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là dessus.
Nicolas. Alors, je vais donner l'exemple de Sillex parce qu’on vend et en numérique et en physique. Nos livres physiques on les vend 25 euros, c'est le prix public, prix unique du livre, etc. Et les livres numériques on les vend à 8 euros. Je pense que, par ouvrage, on vend à peu près 400 exemplaires physiques, et de l’autre côté, allez si on vend 20 exemplaires numériques c'est le bout du monde. Donc il y a une progression de la consommation numérique, ça je ne le nie pas. Allan ou Pierre-Marie pourrait le confirmer ou non, mais ça reste vraiment très marginal. Par contre, je suis d'accord que ce qu'on intègre pas dans les chiffres de progression de la lecture, etc. c'est des lectures un peu moins traditionnelles, si j’ose dire. Je vois le développement ces dernières années du webtoon par exemple qui ne fait qu’exploser enfin on est sur des chiffres qui sont démentiels. Enfin là, pour le coup, Bénédicte, je pense que tu confirmeras.
Bénédicte. Oui totalement ; mais qui de base était une édition numérique à l'origine et qui est passée en papier, donc qui possède un format qui est fait pour le numérique.
Nicolas. Mais du coup, ça fait partie de ces modes on va dire nouveaux, de cette consommation nouvelle de lecture qui n'est pas inintéressante à observer.
Allan ?. Juste deux chiffres qui peuvent vous intéresser. En 2017, 2% des parutions étaientt en numérique seulement, sans compter celleux qui font du broché plus du numérique. En 2023, c'était 1% de numérique seul, donc ça veut dire qu'il y a toujours la double publication générale. Je vous rappelle qu’on parle toujours des éditeurices traditionnel·les, j'insiste parce que c'est important.
Par contre, on ne parle pas d'un autre sujet qui est le livre audio, qui avait 102 parutions en 2017, 230 en 2021 et 200 en 2023, c'est-à-dire qu'on a quand même une progression relativement forte aussi du livre audio.
Question 3. Bonjour, déjà merci pour ces échanges très intéressants. Deux remarques, la première, vous parliez de comment fabriquer des lecteurices. Je travaille en bibliothèque, donc je peux donner modestement un élément de réponse qui est qu'on essaie surtout de valoriser toute forme de lecture, donc ça inclut les webtoons, les mangas et la littérature d'imaginaire qui est très lue par les jeunes. Mais en même temps, il y a un peu un recul,, on a du mal à en acheter parce qu'on préfère acheter de la fiction un peu plus “noble”. Donc il y a cette espèce de paradoxe-là où en fait, ce qui fait lire les jeunes, ce n'est pas forcément ce qu'il y a le plus mis en avant dans certains fonds. Donc c'est très compliqué et il y a aussi ce paradoxe de, on lit moins de fiction, mais la lecture n'a jamais été aussi importante. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui suivent des gens qui ne savent pas lire. Et c'est l'horreur, c'est-à-dire que si vous voulez un compte sur un réseau social, il faut savoir lire, sinon c'est impossible. C’est cette espèce de paradoxe : la lecture n'a jamais été aussi nécessaire, mais on lit moins de fiction, c'est très bizarre. Et l'autre question que j'avais c'était : est-ce que l'explosion d'internet et le fait qu'on soit au courant de ce qui se fait ailleurs, d’une forme de mondialisation de l'imaginaire, ça ne participe pas à la surproduction ? Parce qu'on va importer beaucoup de fictions américaines, mais aussi d'autres pays où ça s'ouvre petit à petit. Alors ça est une très bonne chose, mais du coup est-ce que ça participerait pas aussi à saturer le marché ?
Stéphanie ou Fanny ?. Je veux bien rebondir sur la question de la lecture, et puis je vous laisse ensuite répondre sur la partie qui concerne les questions d'importation et de surproduction. Le rôle des bibliothèques est vraiment essentiel, cœur sur vous les bibliothécaires ! [rires] Ce qui m'interroge, moi, c'est dans la dimension marchande de l'industrie du livre, et j'utilise souvent une image, un paradoxe qui est un peu provoc mais bon : pour l'industrie du livre, si tout le monde là aujourd'hui se mettait à acheter deux fois plus de livres, mais parce qu'on n'a plus de bois et qu'on va les brûler dans les cheminées, ça marcherait hyper bien. Et si là, toustes, on se met à lire deux fois plus mais qu’on ne va que dans les bibliothèques, ou qu’on se prête des livres entre nous, le système s'effondre. Donc, en fait, la lecture n'a aucune valeur économique dans l'industrie du livre. Que les gens lisent ou non, ça n'a pas de valeur économique. Et donc le fond de ma question c'est comment on arrive à inventer des nouvelles manières de faire où, en fait, ce qui crée de la valeur, c'est pas de produire des objets, c'est que les gens lisent des œuvres. Et c'est pas simple, une fois qu'on a dit ça.
Nicolas. Pour le coup, et là l'Observatoire a des chiffres là-dessus, il y a une explosion de ce qu'on appelle les beaux livres, donc des éditions collector, ça va effectivement à 200% dans cette direction là, qu'aujourd'hui la lecture a très peu de valeur. Donc maintenant on cherche à pousser en avant des objets-livres. On est en mode : “il faut que vous ayez des jolies bibliothèques, et, à la limite, ça nous suffit, en tant qu'éditeurices”. Et ce n'est pas tout à fait faux. Moi je suis toujours heureux d'avoir des échanges avec les lecteurices, mais si vous venez me voir et que vous me dites : “j'ai piraté votre bouquin, franchement il était fou !” je vais être content d'une certaine manière, mais je vais aussi être un petit peu triste. [rires]
Bénédicte. Nous avons des chiffres.
Pierre Mallan ??? Alors, pour répondre à la question sur les bibliothèques, dans le cadre des Mycéliades, j'ai fait une rencontre professionnelle pour expliquer à l'ensemble des bibliothécaires ce qu'étaient les littératures d'imaginaire et les leviers pour les faire découvrir et les approcher. Encore une fois, je pense que les réseaux associatifs peuvent aider les bibliothécaires à puncher le truc. Même si j'ai aucun doute sur le fait que vous le fassiez vous-même, bien sûr. La part de francophone, dans un premier temps, même s'il y a une baisse depuis 2017, on est passé de 59% à 51, mais 51% de la production en nouveautés est française. Et je crois que c'est une particularité du monde de l'imaginaire qu’on retrouve dans tous les pays, c'est-à-dire qu'on a toujours une prédominance de l'imaginaire local sur l'imaginaire international. Donc ça c'est pour répondre à la question sur les imports. On est dans les mêmes mécaniques, je pense, que le cinéma. Et en termes de beaux livres (j’ai les chiffres aussi, t’as vu ?) : en 2017, on a 6 beaux livres, reliés, collectors (alors après je vous laisse définir ce qui est un beau livre ou non), en 2024, on en a 183. Et en 2023 c'était 106, on est à 180% d'augmentation.
Bénédicte. Sachant qu’on voit aussi une énorme augmentation de tout ce qui est jaspage et compagnie parce que technologiquement parlant, on y a beaucoup plus d'accès qu'en 2017. Ce qui contribue à faire de beaux livres en fait.
Et juste la minute écolos mais l'adm notamment, mais pas que, à publier des études sur le cycle de vie d'un livre c'est à dire regarder sur l'ensemble de sa vie, production fabrication transport usage fin de vie. Qu'est-ce qui est le plus polluant sur plein de critères, les émissions de gaz à effet de serre, l'usage de ressources naturelles métalliques, la pollution de l'eau, la pollution de l'air tout ce qu'on veut. Et de très très très très loin c'est la phase de fabrication du livre qui a le plus d'impact. Donc la question c'est bien sûr comment on fabrique mieux et donc effectivement est-ce que l'anoblissement les jaspages les vernis les pelliculages les paillettes les machins est-ce que c'est mieux disant écologiquement ou est-ce que c'est juste mieux disant parce qu'on va te vendre plus cher etc et ensuite comment fabrique moins Parce que la vraie question, c'est ça.
Et parce que du coup, petite précision, quand vous, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une explosion des prix, par exemple le prix du papier à exploser. Et donc, en fait, quand vous vous trouvez dans une situation où pour avoir le même ouvrage qu'avant, vous payez le double et qu'on vous dit, du coup, par contre, il y a des choses qui n'ont pas évolué, par exemple, le prix des vernis sélectifs, vous les mettez. Alors qu'avant, vous ne les mettez pas. Parce que du coup, vous vous dites quitte a déjà payé énormément en transport, énormément en papier, autant que ce soit un beau livre pour effectivement pouvoir le vendre un peu plus cher ou le qu’à échéant.
Alors, vu l'heure, on va prendre une toute dernière question. Et s'il y a une femme qui vous pose une question, sinon, je vois toujours rien, donc allez-y, je vois rien du tout. Sinon, allez-y, franchement, une dernière question.
Merci beaucoup, merci beaucoup pour la table ronde. Vous en avez un tout petit peu parlé. Je voulais savoir s'il y avait des équilibres à repenser entre le grand format et le poche, que ce soit pour des enjeux de production ou des enjeux de prix.
Je ne sais pas s'il faut des équilibres. Il y a, alors là, c'est sur les nouveautés. Donc, on a 9 % de nouveautés en poche en 2023. Le reste, c'est la réédition.
C'était l'intervention la plus utile.
Ça revient sur la question de monsieur avec le livre d'occasion. Je pense qu'aujourd'hui, le poche, c'est un bon remède pour donner une seconde vie à des livres qui ont été édités en grand format pour les personnes qui n'auraient pas pu les acheter en grand format. Après, je n'ai pas d'avis sur la partie, sur ta partie à toi.
Je n'ai pas d'avis complètement tranché non plus. Il y a plein d'éléments. Un livre de poche en moyenne, c'est deux fois moins lourd qu'un livre broché. Et donc d'un point de vue strict environnementale vu que l'impact principal c'est le papier si j'utilise deux fois moins de papier, je divise par deux les impacts je divise par deux les poids transportés donc d'un point de vue environnementale ça paraît intéressant. Ceci dit, le vice est toujours dans les détails, le livre de poche il est moins robuste il est moins durable dans le temps et donc il va avoir plus tendance à être à usage unique il va moins traverser le temps même si on a tous dans nos bibliothèques des livres de poche qui date des années 80 et qui sont encore là mais qui sont un peu tristouilles, il vieillisse moins bien que les brochés. Donc peut-être qu'il y a une question sur finalement est-ce qu'on va en fabriquer plus. Typiquement un livre de poche qui fait un retour de librairie il va être détruit quasiment à 100%, c'est beaucoup plus cher de le trier, le réintégrer en stock que de le détruire et de le réimprimer. Par ailleurs on parlait du fait que ça relance les brochés, moi j'ai rencontré des éditeurs et j'avoue que j'ai un suis sorti traumatisé qui me disait oui alors on va le ressortir en poche comme ça on va le remettre à l'office vous savez les nouveautés les 313 nouveautés mais du coup on va détruire le stock ancien de brochés parce que de toute façon il se vendra plus. Et donc on est dans un truc on se dit pour vendre la même œuvre qui existe déjà dans un format brochée qui est plus noble, qui est plus beau et qui a déjà été fabriqué, on va détruire les brochés pour le retirer en poche qui va être quand même plus ou moins jetable.
Oui, et c'était le point sur lequel j'ai conclu... Enfin, sur cette question du poche, parce que c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas abordé, parce qu'on est beaucoup de gens qui le considèrent comme un bien jetable, c'est-à-dire qu'ils vont le lire, ils vont le laisser dans le métro, ils vont le laisser dehors, ou ils vont même carrément le balancer, parce que finalement c'est juste... Alors maintenant c'est dix balles, le livre de poche, donc quand même un poche, donc voilà. Mais ils vont dire, c'est dix balles, donc voilà. Alors que le brochés, il va y avoir un aspect collection aussi qui lui donnera une durée dite, peut-être un peu plus longue.
Le brochée, c'est un marché de nouveautés, le poche, c'est un marché de fonds. Voilà, en gros c'est ça. Donc effectivement, quand ce que vous voulez pousser, d'un point de vue marketing, c'est de la nouveauté, donc essayez de faire un maximum de ventes, etc., vous allez être sur des ouvrages qui vont être plus souvent des grands formats. Et par contre, quand l'ouvrage est arrivé au bout de son exploitation traditionnelle en grand format, et bien quand il s'agit de le mettre en fond, les ouvrages en fond qui coûtent plus de 20 euros, c'est très compliqué à écouler. Donc du coup souvent, ça bascule vers du poche.
Et juste très vite, ça pose quand même la question du prix, à la fois de l'acceptabilité et on sait que le pouvoir d'achat n'est pas infini. Et par contre aussi de la rémunération des auteurs, mais même des libraires et des maisons d'édition, une fois que le prix... Il y a une question générale autour du prix du livre qui a relativement peu, même s'il a augmenté ces derniers temps pour compenser les effets d'augmentation du prix de la matière première. En fait, il n'a pas suivi l'inflation. Donc ça nous barraigère parce que le pouvoir d'achat s'érode et que nous tous mettre à un brocher 25 euros, c'est compliqué. Il n'empêche que le prix relatif du livre, par rapport aux autres biens, il a plutôt beaucoup diminué dans les 30, 40 dernières années, ce qui fait partie de l'érosion de la rémunération de tout le monde.
Surtout ce qui a été dit, je vais un peu à contre-sens, parce qu'il existe un nouveau marché qui arrive depuis 4, 5 ans, on va dire comme ça, qui a tous les avantages du poche, la taille... le prix etc. Mais qui est un marché de nouveautés qui est le marché des novellas. Vous avez Une Heure Lumière chez le bélial, vous avez Récif chez argyll vous avez vous en avez plusieurs mais là de tête j'ai un peu du mal ce sont c'est un marché de nouveautés qui sort sur des formats poches avec un prix accessible. Et c'est aussi une façon dont les éditeurs énormément de l'imaginaire s'engagent à être aussi au service du portefeuille du consommateur.
Tout à fait alors on pourrait continuer comme ça pendant deux heures encore je pense mais je vais me faire engueuler parce qu'on est déjà à la bourre et en plus il y a d'autres conférences dans la salle je vous remercie tous les cinq pour cette pour ces interventions. Merci à vous dans le public.