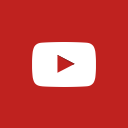Marraine du festival L’Ouest Hurlant en 2025, Laura Nsafou est écrivaine et blogueuse afroféministe. La réappropriation des mythes et des imaginaires issus d’Afrique, des Caraïbes ou du Brésil est au cœur de son travail, particulièrement pour l’écriture d’héroïnes noires. Avec elle, décryptons ses méthodes d’écriture, entre filiation, introspection et examen des représentations dominantes autour des héroïnes noires.
Enregistré le 18/04/2025 à la Bibliothèque des Champs Libres à l'occasion du festival L'Ouest Hurlant.
Avec Laura Nsafou (Modération : Lia Warsa)
Transcription
Adénora. Bonjour à toutes et à tous, au nom de toutes les équipes des Champs Libres, nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau vendredi de la Bibliothèque, un vendredi sous le signe de la littérature et notamment celle des imaginaires, puisque nous avons le grand plaisir d’accueillir aujourd’hui Laura Nsafou, autrice, bloggeuse afroféministe et marraine de l’édition 2025 du festival L’Ouest Hurlant, avec qui nous avons donc l’honneur de co-organiser cette rencontre et qui débutera dès demain [19 et 20 avril 2025] si je ne me trompe pas et jusqu’à dimanche 20 avril au théâtre de la Paillette à Rennes. Donc avant de laisser la parole à Lia Warsa, qui va, ce soir, modérer la rencontre, je souhaite déjà vous remercier d’avoir accepté notre invitation et remercier le festival de nous avoir contacté et de co-organiser cette rencontre. Et juste aussi vous dire qu’il y aura à l’issue de la rencontre une séance de dédicace avec la librairie La courte Echelle, qui du coup s’associe aussi à cette rencontre. Donc n’hésitez pas à vous rapprocher du libraire et puis demander une petite dédicace à Laura. Et je laisse la parole à Lia Warsa pour annoncer et donner des informations sur le festival et je vous souhaite une très belle rencontre.
Lia Warsa. Bonjour à tous, merci d’être venue si nombreux. Alors pour présenter rapidement le festival, on est l’association 18h05 et on organise le festival Ouest Hurlant depuis maintenant 4 ans. C’est à la Pailette, le parc Saint-Cyr, c’est ce week-end et vous pouvez y retrouver des conférences, des ateliers, des masterclass, des auteurs en dédicaces, des créateurices, des animations. Donc n’hésitez pas à faire un petit tour sur le site internet et à nous retrouver dès 10h demain matin. Laura Nsafou, qui est avec moi ce soir.
Laura Nsafou. Bonsoir.
Lia Warsa. Donc, comme Adénora l’a nous dit, c’est une autrice et une bloggeuse afroféministe, elle a écrit de nombreux albums jeunesse, des BDs et ce qui nous intéresse aujourd’hui, des romans de young adult imaginaire. Donc nous avons la trilogie dystopique Nos jours brûlés et son préquel La mer chantera ton nom. Et ce soir, nous allons donc parler de se réapproprier ses mythes et de réécrire ses héroïnes noires.
Laura Nsafou. Alors, déjà merci au festival Ouest Hurlant pour son invitation et merci à vous de vous joindre à cette première rencontre qui ouvre le bal. Du coup, est-ce que c’est toi qui commence avec une question ?
Lia Warsa. Du coup, pour commencer, si vous n’êtes pas très familier avec le mot {afro futurisme, afro fantasy} pardon, il y a trop d’afro tout finalement, c’est l’afroféminisme dont on va parler ce soir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision, des afroféministes qui t’inspirent et comment tu es rentrée un peu dans ce courant de pensée féministe ?
Laura Nsafou. Plusieurs questions en une fois. Alors peut-être commencé par la définition de l’afroféminisme. C’est un mouvement de lutte qui est centré sur les discriminations et les oppressions vécus par les femmes noires et donc qui prennent la conjonction entre le racisme, le sexisme, le mépris de classe et tout ce qu’une femme noire peut rencontrer. C’est un mouvement qui m’a notamment marqué parce que ça m’a permis de comprendre mon expérience en tant que femme noire née en France d’une mère martiniquaise et d’un père congolais né à Orléans. Pour donner un peu une idée de ce que ça veut dire de construire cette identité, lorsque j’allais en Martinique, on me disait « t’es métropolitaine », lorsque j’allais au Congo, on me disait « t’es française, tu as le passeport bordeaux » et en France, on me disait « retourne chez toi ». Donc, quand on se construit dans un contexte comme ça, c’est cette espèce de triangle où on se dit « mais où est ma place ». Et c’est vrai que ce point de départ lorsque j’ai ouvert mon blog Mrsroots.fr, qui est l’espace que je tiens encore aujourd’hui pour questionner et aborder les questions d’afroféminismes. C’était comment me définir quand dans une société à la fois raciste, sexiste, classiste, ect et comment me nommer en dehors de tout ça. Moi, j’ai pas fais des études de sociologie, j’ai pas fais des études de sciences politiques ou quoi, tout ce que j’avais, c’était des livres de fiction et donc, je me suis demandé, peut-être que je devrais commencer par l’imaginaire autour des femmes noires pour comprendre ma place. Et au fur et à mesure, c’est par la fiction afroféministe de beaucoup d’autrices, que ce soit Toni Morisson, Alice Walker, Mariah Maba, qui est une autrice sénégalaise et du coup peut donner une perspective d’un féminisme africain, les autrices anglophones que j’ai listé m’ont donné une perspective de ce qu’était le black feminism, donc le féminisme noir américain. Et puis, après, des autrices aussi caribéennes, comme Simone Schwartzbart, grand autrice Guadeloupéenne, Marie Scondé, etc. Mais ça dessinait toujours ce petit espace qui est l'expérience d'une femme noire dans un contexte occidental et hexagonale dans mon cas. Et donc, j'ai cherché, cherché, cherché, et puis, au fur et à mesure que j'ai vu les stéréotypes, les tropes, etc., je suis allé chercher aussi une mémoire féministe noire française, et il y en a une. Et même si on la redécouvre aujourd'hui avec les soeurs nardales, il y a aussi la coordination des femmes noires des années 80. Donc, tout ça pour moi, c'est aussi des femmes noires qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont permis de comprendre que mon expérience, c'était pas dans ma tête, c'était pas exagéré, c'était pas une tentative d'imiter ce qu'on dit aux Etats-Unis. Non, c'était... Il y a un afroféminisme, en fait. Il y a un afroféminisme, donc il y a un terme politique pour nommer mon expérience et les oppressions que je subis en tant que personne.
Lia Warsa. Et du coup, comment tu présentes ça dans tes héroïnes que t'écris, par exemple à travers Elikia ou Ino, comment tu montres tout cet afroféminisme ?
Laura Nsafou. Alors je ne pense pas. C'est toujours la question qu'on me pose, c'est-à-dire où commence l'afroféminisme dans mon univers ou où il se situe, mais je pense que ça nourrit surtout ma créativité, c'est-à-dire que d'un point de vue très factuel dans le world building de Nos jours brûlés, donc dans la construction du monde, une position afroféministe, c'est de montrer une diversité de femmes noires. Et ça veut dire quoi montrer une diversité de femmes noires ? Ça veut dire montrer une diversité de femmes noires en termes de caractère. Donc c'est quoi montrer une femme noire agressive ou en colère, mais qui ne correspond pas aux tropes racistes de la femme noire en colère ? Ça veut dire aussi montrer une diversité de femmes noires en termes de carnations, de physiques, ou qui ont des identités de genre différentes, ou des orientations sexuelles différentes, etc. Donc c'est démontrer une panoplie de femmes noires différentes, déjà, réalistes, et surtout avec une réelle agentivité. Pourquoi je dis réelle agentivité ? C'est parce que la littérature française s'est construite autour d'un imaginaire avec, pour, personnage principale, neutres par défaut, un homme blanc, cis, valide, héros, etc. Et donc quand on voit des femmes noires en littérature française, c'est souvent des ressorts scénaristiques. Ça va être la nanny, ou la nounou, donc. Ça va être l'esclave, ça va être... Voilà, c’est toujours un personnage secondaire qui va être cette espèce de marche-pied d'une intrigue. Ça va être peut-être l'objet hyper sexualisé, exotismisé, donc symbole d'exotisme et tout ça. Mais donc l'agentivité, ce que ces personnages ont à dire, sont ou ont à raconter, on n'a pas beaucoup d'exemples en littérature française. Et très souvent quand on a des exemples comme ça, c’est une littérature caribéenne ou anglophone et africaine. Donc pour moi, déjà, c'est un parti pris, je dirais, afro-féministe de faire ce travail-là, mais qui n'est pas un effort parce que des femmes noires, j'en vois partout. J'en vois partout. La question, c'est comment on fait, justement, aussi pour questionner aussi la manière de raconter les femmes noires. Et ça, c'est un deuxième travail que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la langue française, quand on parle, quand on a des expressions qui sont liées à la couleur noire ou à quelque chose de sombre, c'est souvent dépréciatif et négatif. Mais comment on décrit une peau noire sans passer par le mot ébène, sans passer par le mot chocolat, le mot café au lait ? En fait, tous ces marqueurs qui sont les marqueurs coloniaux et qui ont une histoire, etc. Comment on fait pour proposer un autre langage, un autre vocabulaire ? Ça, ça se travaille aussi. Et ça, pour moi, c'est aussi une réflexion qui est nourrie par mon afro-féministe. Donc, ce n'est pas qu'il y a un agenda afro-féministe dans mon travail. Il est là, clairement. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, enrichit mon imaginaire dans ce que j'ai envie de proposer. Et le plus gros partie pris qui clairement était aussi une décision dans l'univers de nos jours brûlés, c'était montrer des femmes noires monstrueuses. Ça, c'était vraiment... Ça, on veut dire, c'est peut-être un agenda afro-féministe, peut-être, dans le sens où, pourquoi ? Parce que, là où, dans un imaginaire colonial, les femmes noires, même dans un imaginaire occidental, ont été présentées toujours comme quelque chose animalisé, hyper sexualisé. Si je reprends, même Saartje Baartman, la venus hottentote, c'est son corps qui posait questions, c'est ses rondeurs qui posaient questions, c'est ses rondeurs qu'on a disséqué, etc., etc. Donc, comment tu abordes la question de monstruosité en imaginaire quand tu as tous cet imaginaire colonial autour ? En fait, tu te sens cette monstruosité comme une puissance chez ces femmes noires. Et aussi, ça questionne plein d'aspects aussi moraux, ça questionne plein d'aspects politiques. Et j'aimais le fait de créer des femmes noires qui se réclament de cette monstruosité-là, qui a différentes formes, selon que ce soit Ino, Elikia ou Diarra, et qui, à chaque fois, perturbe le monde autour et perturbe aussi le statu quo et peut peut-être amener un imaginaire de libération.
Lia Warsa. Et du coup, comment t'as choisi les divinités sur lesquelles tu t’es appuyé ? Comment t'as choisi les descendances, leurs caractéristiques aussi ? Parce que, du coup, dans la diaspora africaine, on retrouve régulièrement les mêmes divinités sans avoir forcément le même nom ou les mêmes caractéristiques. Donc, comment t'as fait ton choix ?
Laura Nsafou. Alors, déjà, il faut le dire, c'était six ans de recherche. Donc, déjà, il y avait, je pense, ce travail de voir ce qui existait, parce que là encore, aujourd'hui, il n'y a pas d'encyclopédie. Et si quelqu'un veut le faire, faites-le. Mais il n'y a pas encore d'encyclopédie sur les mythologies d'Afrique. T'as très souvent des livres sur la mythologie égyptienne. Si on a un peu de chance, on va trouver quelques livres sur les dogons, donc propre au Mali et les orichas, du coup, avec ce pont qui est fait entre le Brésil et le Bénin. Et peut-être qu'en creusant un petit peu, voilà, il y a des petites spécificités, mais on n'a pas encore une grosse encyclopédie, comme on pourrait l'avoir sur d'autres mythologies. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, mais donc la première étape, c'était où tu vas, quelle ressource tu vas chercher pour trouver ces informations-là, quand elles ne sont pas en librairie, quand elles ne sont pas accessibles. Donc moi, j'ai commencé à demander autour de moi. J'ai demandé à des amis camerounais, sénégalais, caribéen, etc., les histoires qu'ils avaient entendues petits. Et effectivement, comme tu le dis, souvent, il y a des divinités, des entités qui reviennent. Mami Wata, c'est aussi Maman de l'eau dans la Caraïbe, c'est aussi Oshun chez les orichas, c'est aussi Yemaya. Et donc j'ai finalement fait un travail de synthèse de ce qui revenait le plus souvent, comme la forme du serpent, par exemple, avec Bounzi, bon, je ne sais pas tous les citer, mais il y en a plein. Et surtout, pour définir les attributs, voir les attributs qui revenaient plus souvent. C'est-à-dire que là où le serpent, dans un imaginaire occidental, est souvent rattaché à la tradition chrétienne, avec ce truc très négatif qui va amener dans les ténèbres, le vice, etc., en Afrique et aussi en Asie, on ne va pas faire de la mythologie comparée maintenant. En Afrique, c'est symbole de vie, de fertilité, d'infini, de renouvellement. Donc j'ai aimé aussi choisir des divinités qui questionnent nos propres repères en tant que français et occidentaux. Et donc j'ai essayé de, après, il fallait faire un choix. Et le dernier critère, c'était aussi de m'appuyer sur les panthéons qu'on retrouve très souvent, c'est-à-dire que dans toutes les civilisations, il y a toujours une divinité de la Terre, il y a toujours une divinité de l'eau ou du soleil ou de la Lune, donc faire des choix aussi qui permettraient de donner des repères au lecteur et les synthétiser.
Après, c'est pour ça qu'il y a les demi-dieux et qu'après, on complexifie le tout.
Lia Warsa. Quelle belle transition, parce qu'on va parler des demi-dieux, du coup. Comment... Quel était ton envie de montrer par rapport au fait que ce sont des personnages qui sont très différents, on va dire, dans l'univers, qui ont vraiment un impact très particulier et qui ont une relation aux autres très particulières, parce qu'ils sont souvent mal vus. Comment t'as pensé à toutes ces idées et qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message avec ces personnages-là, parce qu'il y en a beaucoup.
Laura Nsafou. Oui, j'allais te demandé lesquels ?
Lia Warsa. Alors Elikia, qui est quand même, dès le début, elle sait pas sa place dans l'univers. Quand elle rencontre, j'avoue, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment il s'appelle, l'éclaireur. Il a beaucoup de mal à lui faire confiance, parce que son statut de... J'ai peur de spoiler en disant trop de détails, donc on va rester là, mais son statut particulier fait en sorte qu'elle crée la méfiance autour d'elle. Il y a Diarra aussi, qui a une ascendance très particulière et qu'on comprend mieux dans la mer chantera ton nom. Et pareil, les personnages Ino, qui est en quête d'elle, en quête de son histoire familiale, qui est, du coup, également demi-déesse, c'est un peu flou encore. Du coup, comment t'as réfléchi à toute cette création de personnages qui sont entre deux univers, qui sont ni vraiment humains, ni vraiment mythiques, déesse et tout ça ?
Laura Nsafou. Tout simplement par l'hybridité, c'est-à-dire que, outre la question, je voulais sortir de la question déjà du métissage, parce que ce n'est pas seulement une question de métissage dans le cadre de ces personnages-là, c'est vraiment une question d'hybridité par rapport à leur corps, par rapport à leur rapport au monde, par rapport à leur pouvoir. Et en fait, amener le lecteur aussi dans ce monde où, au moment où il se dit, ah, ok, j'ai compris comment ça marche, t'as des personnages qui font bugger le lecteur, qui disent, ah, pourquoi il est à cheval sur un, deux ou trois éléments, j'essaie de pas spoiler non plus, et j'aimais cette idée, en fait, de montrer qu'il n'y avait pas vraiment de règles, et surtout que quand, là où on aurait une vision de se dire, bah, en fait, ce personnage, il est au croisement de différents pouvoirs ou de différentes créatures ou divinités, etc., etc., c'est une évolution normale des choses. Donc, en fait, c'est aussi une forme d’eugénisme entre très gros guillemets, qu'ont les dieux de dire, mais c'est pas normal que ces êtres existent, etc., etc., et c'est une catégorisation, en fait, aussi, que les gens reproduisent. Et comme tu l'as dit, il y a plein de personnages qui sont concernés, preuve qu'il est très facile, en fait, dans un univers où on questionne la puissance des dieux, les normes et l'ordre établi, de reproduire encore des catégorisations, des normes, des rapports de force, etc., etc. C'est ce qu'on comprend avec ces personnages-là, ne serait-ce qu'en termes de générations, j’essaie de pas spoiler non plus, Ino, Diarra et Elikia, elles ont carrément des décennies de différence, et à chaque fois, elles posent un différent angle d'hybridité. Et ça, je trouvais ça aussi très intéressant de mettre le lecteur dans une position où il est en solidarité avec ces hybridités-là. Et il voit à chaque fois, et j'espère, c'est un peu mon but aussi, c'est que chaque fois que le lecteur pense avoir exploré une partie de cet univers-là à travers l'un de ces personnages, il se dit, OK, là, je peux plus être surpris. Et bien, en fait, on y revient encore, c'est aussi que poser la question de l'identité, il n'y a pas d'identité figée, en fait, selon les expériences que l'on a, selon la nationalité à laquelle on est rattaché, selon l'identité perçue, il y a tellement de facettes différentes qui sont des portes d'entrée vers l'identité de quelqu'un que j'aimais aussi montrer ce caractère un peu mouvant de l'identité.
Lia Warsa. Du coup, dans leur hybridité, ce sont des personnages qui ont beaucoup de pouvoirs, qui ont des puissances différentes, pas toujours comprises également, mais il y a un aspect qui est très important, c'est qu'ils sont très humains, qu'ils ont énormément de faiblesses, de défauts. Comment t'as travaillé toute cette caractérisation autour de ce personnage pour que t'es un mix entre ils sont puissants, ils sont spéciaux, un peu, ils sont différents des autres, mais ça reste des autres humains, ça reste des gens qui ont des idées, des opinions, des défauts.
Laura Nsafou. J’aime bien comment tu insistes sur le défaut. Mais c'est ça, pour moi c'était la meilleure partie, en fait. Pour moi c'était la meilleure partie dans le développement de ces personnages-là. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est l'histoire des personnages. C'est-à-dire qu'on voit par exemple Ino, qui est donc né en France, de parents sénégalais, mais qui n'est jamais allé au Sénégal, et qui va se retrouver au Sénégal parce qu'elle a été punie, sanctionnée par sa famille. Et donc ce rapport à ça, et qu'on la découvre dans ce contexte-là, ça a dit quelque chose d'elle. Et la particularité aussi d'Ino, c'est que dans un seul tome, on la voit grandir et devenir adulte. Là où dans Nos jours brûlés, on a une temporalité sur 5 ans de plusieurs personnages, avec Diarra, etc., voire 5 ans, 6 ans. Donc je pense aussi suivre leur développement, pour moi ça m'a aidé à les voir des gens comme personnes, et finalement les pouvoirs viennent au fur et à mesure de cette progression-là. Mais il n'y a pas d'élus aussi, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de savoir ou de pouvoir auxquels ils se sont préparés, il n'y a pas d'initiations. On est face à des personnages et surtout des héroïnes qui cherchent leurs initiations toutes. Elles n'ont pas été préparées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont les descendantes aussi d'un peuple qui a eu ses savoirs pillés et effacés et perdus. Et donc les voir en lutte par rapport à ça, ça rend forcément humain, parce que je pense qu'on a tous dans notre vie une recherche à un moment donné de notre vie, c'est-à-dire soit à se comprendre, soit par rapport à l'histoire de nos parents, soit par rapport à plein de choses. Il y a plein de choses où je pense qu'on est en recherche pour se comprendre en tant qu'adulte, avant de devenir adulte. Et je crois que pour moi, c'était ça le noyau pour chaque personnage. Et la différence, c'est que dans la trilogie, comme il y a plusieurs personnages, on a différents points d'entrée. Et enfin, l'imperfection aussi, pour moi, c'est un critère, c'est-à-dire que Elikia, elle a vraiment 20 ans. Donc quand dans le tome 1, il y a plusieurs lecteurs et lectrices qui me disent parfois, je vais la secouer, je fais, c'est normal. C'était le but, parce qu'à 20 ans, on n'est pas matures. On fait des choix où tu te dis pourquoi elle fait ça ? Mais en vrai, c'est humain et surtout, on est comme elle. On n'aurait pas fait, à 20 ans, on n'a pas, je ne pense pas qu'on l'a fait ou même à 18 ans, je ne pense pas qu'on a fait des choix ultra réfléchis, on savait déjà se battre, etc. Non, je voulais vraiment montrer une héroïne qui galère, mais qui, du coup, parce qu'elle galère, elle se construit. Et ça, c'était aussi une piste pour toutes.
Lia Warsa. J'aime beaucoup aussi tout ce que tu montres en termes de sororité et de solidarité et même de gouvernance un peu atypique puisque sans trop en dévoiler encore une fois, au fur et à mesure de nos jours brûlés et de la quête dans laquelle on évolue, on découvre tout un groupe de résistants qui sont vraiment très nombreux, organisés en village et donc on a des femmes, des hommes qui travaillent ensemble, qui prennent des décisions de manière horizontale sans qu'il y en ait un plus important que l'autre et les femmes se soutiennent particulièrement, notamment Elikia, qui arrive dans cet univers sans avoir énormément de connaissances et qui est soutenue par plein de femmes d'âge différents qui sont parfois d'accord avec elles, parfois pas du tout mais qui sont toujours là pour la soutenir. Comment t'as pensé un peu à cette organisation de société ?
Laura Nsafou. Par l'afrofeminisme ? En fait c'est en t'écoutant que je me dis qu'il y a vraiment plein de petits fils d'afrofeministes qui sont venus dans cette construction de cette sororité. Non, plus sérieusement, c'était aussi parce qu'il y a plein de thèmes que je trouvais importants de montrer, c'est-à-dire ne serait-ce que l'aspect intergénérationnel, l'héroïne qui va apprendre à tout le monde, mais je sais comment ça marche le monde, j'avais tous à vous apprendre. En fait je trouve que ça ne marchait pas dans ce monde-là, pourquoi ? Parce que nos jours brûlés se passent en 2049 dans un monde où le soleil a disparu et donc Elikia est d'une génération qui n'a jamais connu le soleil. Donc quand sa mère lui parle de c’était mieux avant avec des saisons, certains fruits, certaines agricultures, Elikia ne se sent pas concernée par l'envie d'améliorer ce monde-là. Pour elle, elle a toujours connu un monde obscur, dangereux, avec une nature qui a muté et c'est normal. Donc montrer comment elle arrive à se dire qu'il y a un enjeu dans le monde qui est autour de moi et qui est catastrophique et qui est dystopique, pour se penser comme acteur de changement, faut déjà comprendre qu'il y a un changement autour de soi et pour comprendre ça, faut qu'on ait accès à la mémoire et donc rien que pour ça. Il fallait qu'il y ait une communauté autour, il fallait qu'il y ait cette notion de savoir, etc. Et je pense que cette sororité, elle vient aussi de toutes ces femmes qui ont une expérience particulière dans cette monstruosité-là, quel que soit le type de monstre qu'elles sont, encore j'essaie de pas trop en dire, et qui se retrouvent aussi toujours à un moment donné, même quand elles ne sont pas d'accord de se dire qu'en fait c'est quoi le plus important et surtout tu apprends. Même si Diarra est un personnage extrêmement puissant, respecté, etc. il y a des moments où elle va être dans des confrontations extrêmement difficiles avec Elikia qui est plus jeune qu'elle, mais qui va lui permettre d'apprendre aussi d'autres perspectives et ça aussi c'est des échanges que je trouvais intéressants de montrer. Mais au début, quand j'ai construit ça, pour moi ça allait de pair avec ce que je voulais montrer, c'est-à-dire question de la transmission et comment dans un monde dystopique on construit un espoir politique et comment on se sent concerné dans le fait de changer le monde autour de nous. Et puis un jour, quand je suis allée au Brésil, j'ai rencontré une autrice dont j'oublie le nom, ça me reviendra, donc une autrice afro-brésilienne qui avait écrit un roman Afro-Futuriste et son livre n'est pas traduit en français, mon roman n'est pas traduit en portugais-brésilien, mais on s'est rencontrés et quand on a discuté, la première question qu'elle m'a demandé c'est est-ce que Elikia, dont ton univers afro-futuriste, peut marcher sans communauté ? Je vous avoue que première question, j'ai un peu bégayé et j'ai réalisé que, non en fait, sans la communauté autour, pas forcément en termes d'apprentissage mais sans toutes les collectifs qui est autour d'elle, Elikia peut pas évoluer et n'avance pas et je pense même qu'elle serait morte très vite. Et là, cette autrice m'a dit, elle fait de l'afro-futurisme au Brésil depuis très longtemps, elle m'a dit, mais ça c'est un critère afro-futuriste. Pourquoi ? Parce que le récit du héros comme Hercule qui va seul battre tous les monstres grâce à sa force, grâce à lui-même, uniquement lui-même, rien que lui-même, même si on l'a donné un peu de pouvoir, mais c'est quand même que lui, en fait, ce truc hyper-centré sur le héros qui casse tout et qui sûrement toutes les épreuves tout seuls. Ça aussi c'est un récit situé occidental. Et donc en fait, ça m'a aidé à comprendre que dans l'afro-futurisme aussi il y a des critères comme ça qui sont des traits particuliers aussi aux genres et que le rapport à la communauté et à la sororité, ça en est un.
Lia Warsa. Est-ce qu'il y a d'autres critères du coup pour l'afro-futuriste ?
Laura Nsafou. Est-ce qu'on a deux heures devant nous ? Déjà, le fait de proposer un univers afro-centré, c'est-à-dire que quand on parle d'afro-futurisme, déjà, il faut peut-être revenir à la base d'afro-futurisme, c'est un mouvement artistique qui propose des futurs centrés sur la diaspora africaine ou l'Afrique, mais c'est un mouvement défini aux États-Unis. Or, il s'oppose au futurisme africain, puisque les Africains, à raison, on dit qu'on n'a pas eu besoin d'attendre pour penser nos futurs, mais surtout nous, on revendique des futurs qui pensent uniquement à l'Afrique et pas forcément depuis la diaspora. Et puis, il y a plein de branches, parce que qu'est-ce qu'il se passe quand on est caribéen ? Du coup, il y a un futurisme caribéen qui s'encre qui est dans un des tiroirs de l'afro-futurisme. Donc, c'est un grand chapeau. Du coup, ça pose plein de questions à la fois diasporiques, littéraires, extrêmement riches, un peu comme des discussions familiales. Et c'est vrai que, donc là où tous ces mouvements se rassemblent, c'est le fait de prendre pour centre la diaspora d'Afrique subsaharienne, surtout, et enfin, l'Afrique subsaharienne, la diaspora autour, de proposer des futurs aussi, et surtout des futurs positifs, parce que là encore, pourquoi ? En science-fiction, très souvent, il n'y a pas de personne noires dans les futurs proposés. Et ce n'est pas les seuls absents, parce que peut-être qu'on en parlera, venez à Ouest Hurlant, il y a plein de conférences dessus, mais il y a beaucoup d'oubliés dans les futurs présentés en général, et surtout même l'Afrique qui est absente. L'Afrique n'est pas pensée dans certains grands classiques, etc., qui vous vous disaient juste, il y a eu un cataclysme mondial, sauf, ah, l'Afrique n'est pas là. Donc ça aussi, c'est aussi revendiqué le fait de prendre pour centre ça, mais pas comme une réponse à la science-fiction occidentale ou autre, mais plus comme le fait de dire, dans ce genre-là, on veut explorer toutes ces facettes-là, et surtout une Afrique qui ne serait pas forcément dans un dialogue avec l'Occident. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai aimé tester dans nos jours brûlés, c'est qu'on ne parle pas de l'Occident dans nos jours brûlés. Ce n'est pas un repère, ce n'est pas un point, on se situe juste en Afrique, et au Brésil et dans la Caraïbe, et on voyage et dans d'autres sphères aussi. Et ça aussi, beaucoup de lecteurs ont été intrigués par ça, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude.
Lia Warsa. Du coup on va repartir sur un des angles qu'on n'a pas encore fait, sur plus spécifiquement l'écriture. Comment vraiment en termes de technique d'écriture tu écris tes personnages noirs comment tu les réfléchis pour que t'as parlé rapidement tout à l’heure de ne pas utiliser le vocabulaire colonial. Mais du coup comment tu choisis, comment tu trouves le vocabulaire qui soit le plus juste possible pour t'écrire tes personnages ?
Laura Nsafou. Alors déjà je propose souvent un atelier d'écriture qui s'appelle « de quelle couleur est ta peau noire » qui est en fait un atelier d'écriture exploratoire où je propose aux participants alors c'est un des exercices vous pouvez le faire chez vous. C'est d'avoir une photo d'une personne noire et de la décrire sans utiliser tous les mots qu'on utilise aujourd'hui marron foncé on enlève tout. Et en général quand je propose cet exercice-là tous les participants se liquéfient littéralement et se regardent leurs feuilles et pourquoi parce qu'en fait c'est un exercice créatif aussi d'aller chercher autre chose que le langage auquel on est habitué et ça pour moi c'est une pratique. Donc bien avant d'être face à mon manuscrit et de me dire je vais écrire sur Ino ou sur Elikia etc. J'ai déjà cette pratique dans d'autres ouvrages pour moi de savoir qu'est-ce que je peux faire de différent dans ce livre-là pour décrire ces peaux-là. Donc c'est même pas en termes de justesse c'est juste en termes de vocabulaire et puis surtout d'autres auteurs l'ont fait avant moi. Et un très bon exemple qui m'a énormément marqué c'est dans le livre de Simone Schwartzbart donc l'autrice guadeloupéenne que je mentionnais. Elle a écrit un roman qui s'appelle Tijan et il y a une scène, une page où elle décrit une femme noire foncée de peau qui traverse toutes les émotions et sa peau et donc elle décrit les différentes nuances de couleur de sa peau avec un vocabulaire et des couleurs sur lesquelles on n’aurait même pas misé. Et je me suis dit en fait on a déjà cassé ce que je disais cette imaginaire par exemple les noirs ne rougit pas bah si c'est ce que c'est d'autres sortes de rouges et ça se travaille de le mentionner. Mais aussi de travailler une photographie en fait c'est quoi les différentes couleurs qui sont convoquées dans la gestuelle des personnes noires. Et c'est la même chose en fait en bande dessinée par exemple quand on dessine des afros juste avec des gribouillis mais en fait non ça c'est juste la BD franco belge qui pense que c'est pas un sujet de travailler les textures.
Lia Warsa. Ou de décrire les cheveux en disant qu'ils sont juste farouches, indomptables.
Laura Nsafou. Voilà comme sur les étiquettes de shampoing donc ça aussi ce vocabulaire là ça se travaille et moi je trouve que c'est une richesse créative en fait et une liberté créative de toujours me mettre ça comme défi de qu'est ce qu'on peut créer de plus que la dernière fois Donc c'est plus comme ça que je le réfléchis pour les personnages Ensuite en termes de, tu vois ce que tu parles de justesse je pense qu'il y a toujours, pour moi c'est comme je disais je connais des femmes noires je suis une femme noire donc je construis déjà des personnes donc des femmes noires qui sont au centre de l'histoire mais surtout comme je disais en leur propre agentivité Et puis des fois je me laisse aussi la liberté d'être portée par l'histoire et donc par exemple dans nos jours brûlés il y a une commandante Zahi, une femme noire très dure, très sévère, très agressive et il y a une sc_ne où je me suis dit Ah est-ce que là je suis pas en train de tomber dans l'espèce de cliché de la femme noire méchante etc etc. Et en fait je me suis demandé, en fait j'ai réécrit ce passage jusqu'à ce que ça me semble juste, parce que oui les femmes noires en colère ça existe. Mais surtout comment le raconter, c'est ça aussi que je questionne. Donc en termes techniques ça peut être, oui est-ce que ça passe forcément par le cri ? Non. Moi je pense aussi que la règle d'écriture show don't tell, donc montrer mais ne dit pas tout Je pense que passer par la gestuelle ça a parfois beaucoup plus de pouvoir et c'est aussi beaucoup plus humanisant que de reprendre les tropes Elle hurla ou elle cria ou des choses comme ça. Donc c'est plus des petites choses mais c'est pas planifié. Et aussi parce que j'écris au fil de l'eau, je suis pas quelqu'un qui va faire un plan pour son roman, j'aurais dû commencer par là. J'écris puis après je me dis ça fait 200 pages, il va falloir peut-être … c'est peut-être un roman. Et après c'est à la réécriture que je réarrange les personnages ou le monde etc etc.
Lia Warsa. Je parlais de justesse aussi parce que j'ai été marquée par le fait que tu parles des règles et qu'elle randonne dans la forêt, elle se bagarre, elle sait pas trop en fait ce qu'elle fait elle-même, mais elle a ses règles et ça a un impact sur sa vie parce qu'elle a des douleurs, parce qu'elle est de mauvais poils et ça a même un impact sur ses pouvoirs et du coup c'était vraiment un aspect que je trouvais très intéressant et très juste parce que le nombre de récits qu'on a vu en tant que femmes, ou en fait les questions physiologiques, ça n'existe plus.
Laura Nsafou. C'est ça ! Et surtout sur des années, c'est continuant à forêt, surmontant toutes les épreuves et c'est fou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit merci pour ce passage. Pas seulement en termes de réalisme, mais juste parce que ça crée aussi une proximité et pour moi c'était naturel, j'avoue c'était pas en l'écrivant, je ne me suis pas dit je suis en train de créer un précédent littéraire et tout en littérature imaginaire, mais c'était plus d'un point de vue juste pratique. Alors déjà je pense aussi, oui je vais te préciser, le fait de créer un monde, ça fait qu'on se pose des questions à toutes les échelles, donc je pense que aussi d'un point de vue pratique je me suis dit en fait comment ça se passe pour Elikia, connaissant son pouvoir, pour moi c'était juste une question de world building aussi, et donc de création de personnages en termes de réalisme, qu'est-ce que ça crée ou pas, mais c'est vrai que je n'ai pas vu comme un enjeu. Mais c'est plus une fois que je l'ai écrit, je me suis dit en fait c'est vrai que je ne pense pas avoir déjà vu ça, même dans les héroïnes noires qui m'ont inspiré et que j'adore, mais que je n'ai pas vu cette facette-là en fait.
Lia Warsa. Du coup, dernière question avant qu'on passe aux questions du public, est-ce que tu as un conseil pour écrire les héroïnes noires ? Un seul, attention, c'est difficile.
Laura Nsafou. Un seul ? Internet ! Pourquoi ? C'est à moitié une plaisanterie,parce qu'aujourd'hui, j'ai écrit depuis l'âge de 12 ans et je peux le dire aujourd'hui, il y a tellement de ressources, que ce soit en termes de compte Instagram qui liste tous les tropes et les stéréotypes qu'il y a autour de certaines communautés minorisées, que ce soit en termes, il y a même un guide gratuit, donc le compte Instagram qui s'appelle la Griffe Écriture propose un compte gratuit sur comment décrire des personnages, pas que personnages noirs je crois, en tout cas des personnages marginalisés et des exercices, on a une base, on a des ressources beaucoup plus grandes qu'avant et donc ça ira à de paires et donc on va dire que c'est pas un deuxième conseil, mais un petit peu quand même. Exercez-vous, c'est un travail, c'est un exercice en fait, d'apprendre en fait à écrire ce qu'on ne pensait pas être un sujet parce que c'est ça aussi, c'est qu'on ne réalise pas qu'on a un vocabulaire ou un imaginaire colonial bien présent. Même en tant que personne concernée, mes premières, tous mes textes qui n'ont pas vu le jour en librairie, je ne pense pas que je décrivais très souvent les personnages noirs et parfois ils n’étaient même pas noirs parce que je ne m'autorisais pas à présenter des héroïnes noirs donc parce que j'avais intériorisé aussi cette idée qu'un héros par défaut c'est un personnage blanc. Donc ça se pratique en fait, ça je veux dire, ça se pratique c'est un exercice et puis donnez-vous aussi de la marche pour vous améliorer, voilà ça fait trois.
Lia Warsa. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions dans le public ? Personne n'a de question ? On peut continuer à discuter sinon ?
Public. Bonjour. Ma question est, pas sur l'afrofuturisme, mais plutôt sur l'afro. Il y a des personnes qui se demandent, est-ce qu'on peut opposer l'afro-féminisme avec le féminisme tout court ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question ?
Laura Nsafou. Oh ! Alors, déjà, je pense que c'est une question un peu biaisée, parce que c'est quoi le féminisme ? Il y a des féminismes, et en fait, il n'y en a jamais eu qu'un seul. Et pour moi, ça participe aussi... Alors, je prends le cas français, mais ça participe aussi à cette espèce d'impensé où on se dit qu'il y a un féminisme, mais il n'y a pas de féminisme universel, il y a des féminismes qui permettent de créer un féminisme universel, et le féminisme universel, c'est la somme de tous ces féminismes-là. Je ne pense pas qu'ils s'opposent, je pense qu'ils se complètent. Je ne pense pas qu'il y ait un féminisme au-dessus des autres, et quand il y en a un, c'est un qu'on a normé, cadré, en disant, ça, c'est le féminisme. Mais en fait, il y en a plein, et c'est justement ça qui est nécessaire, c'est de savoir, en fait, je pense qu'il serait plus juste de parler d'une solidarité féministe que d'un féminisme, en fait. Parce qu'une solidarité, ça se construit, et donc là, toutes les femmes peuvent y prendre part. C'est ça la différence. Et surtout, là, je parle d'afroféminisme, mais il y a un féminisme propre aux femmes asiatiques, voilà, il y a différents courants féministes, et même dans l'afroféminisme, il y a différents courants. Donc pour moi, je ne vois pas ça comme une opposition, je vois ça justement comme une approche honnête et véritable du fait qu'on a besoin, en fait, de discuter, de se rencontrer et de débattre pour créer, justement, des solidarités et des ponts entre les femmes. On n'est pas toutes... Même mon expérience de femmes noires, elle est française, elle n'est pas martiniquaises, elle n'est pas congolaise. Et donc moi aussi, je vais aller à la rencontre de féministes congolaises qui vont avoir des expériences différentes de la mienne. Donc pour moi, ce n'est pas une opposition, c'est justement une rencontre. Et je pense que déjà, ça change la question et la perspective. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Laura Nsafou. Ah oui, donc la question, c'est pourquoi je dis que je fais mourir le soleil. Il a disparu, je ne suis pas dit qu'il était mort. Je dis qu'il a disparu. Pourquoi la disparition du soleil ? Ah mais je ne peux pas répondre sans... Sans révéler les quatre tomes.
Lia Warsa. Il faut lire le livre, finalement, pour savoir ça.
Laura Nsafou. Mais je pense, d'un point de vue symbolisme, je pense que justement parce que le soleil, dans la plupart des civilisations, a toujours ce symbole d'espoir et positif. Il y a quelque chose qui rassemble beaucoup autour de la figure du soleil et quelques soit les époques aussi. C'est assez fascinant de voir ça. Je n'ai pas vu encore, après, si vous en connaissez une, je suis curieuse, mais je n'ai pas vu encore une mythologie où la divinité du soleil est méchant, peut portes préjudices aux hommes. Je trouve ça très intéressant, très intéressant. Du coup, ça intrigue toujours quand on se dit pourquoi ça disparaît.
Public. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation, votre oeuvre, tout quoi. Je voulais vous poser une question concernant l'empathie, parce qu'en fait, vous parlez beaucoup des personnages, de la façon dont vous les construisez. Et je sais que dans vos albums jeunesse, il y a beaucoup plus la question de changer un peu le point de vue pour permettre des points de vue alternatifs, notamment par rapport aux cheveux. Ça m'a beaucoup marqué. Et je voulais savoir si dans vos romans, vous essayez aussi de créer cette empathie et donc du coup de créer une sorte de relation à une expérience différente. Et si oui, comment vous faites ?
Laura Nsafou. Alors, merci pour cette question, elle est géniale, je crois qu'on me l'a jamais posé. Donc, merci pour cette question. Déjà, je suis un peu une autrice sadique avec les adultes, je dois le dire. On va souvent souffrir avec les personnages, dans le sens où, non mais ça va bien se passer, si vous le lisez. Mais c'est juste, j'aime bien l'idée, c'est pas juste faire souffrir le personnage, c'est que le mettre face à des dilemmes. Par exemple, dans La Mère chantera ton nom, les trois personnages qu'on suit ont tous un dilemme particulier. Il y a un personnage, c'est est-ce qu'il a le choix entre effacer le passé où il a été esclave, pour justement ôter l'esclave du monde entier, mais ça voudrait dire du coup effacer la femme qui l'aime, puisqu'elle descend de cette histoire. Il y a un autre personnage, elle se demande si, j'essaie de poser la question sans spoiler, est-ce que aimer l'autre, c'est se trahir par rapport aux aspirations qu'elle a de se découvrir, de connaître sa vérité. Donc en fait, c'est des questions extrêmement larges qu'on peut tous se poser, et que je resserre après de plus en plus comme un étau au fur et à mesure de l'intrigue. Et à la fin, on se demande vraiment ce qu'ils vont choisir. Et j'aime l'idée que l'empathie en fait se fait à chaque fois qu'on se dit, moi j'aurais fait ça ou je n’aurais pas fait ça, ou j'aurais fait comme ce personnage-là, ou je n’aurais pas fait comme ce personnage-là. Et à la fin, on a mal avec lui, on pleure avec lui, on est content avec lui. Pour moi, c'est vraiment dans cette espèce d'étau qui se referme au fur et à mesure de l'intrigue qu'on crée un pont avec les personnages. Et ça, c'est la partie technique en termes d'écriture. Après, en termes d'empathie, c'est tout simplement aussi parce que mes personnages pour moi sont des personnes. Je vis avec ces personnages. Et quand je dis que je vis avec, c'est-à-dire que je suis capable de savoir quel timbre de voix ils ont, qu'est-ce qu'ils diraient ou ne diraient pas. Donc c'est des personnages avec lesquels j'ai vécu depuis 8 ans. Et donc, en fait, je suis capable de les décrire comme on décrirait quelqu'un qu'on connaît très, très, très bien. Et je crois que c'est ce qui se ressent aussi dans l'histoire ou dans l'écriture. C'est pour ça qu'on voit leur défaut. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec eux, mais qu'on a envie de les suivre quand même. Il y a quelque chose autour de très humains que je ressens pour eux et que j'essaie de remettre dans cette histoire-là. Et la preuve étant que quand j'ai écrit le personnage d'Elikia, donc au bout d'un moment quand j'ai décidé de faire un plan parce que ça faisait quand même déjà trois temps, j'avais prévu qu'Elikia irait dans telle direction et au moment où j'arrive en fait au chapitre que je dois écrire, ça marche pas. Donc je suis là, je me dis ben... Non, mais ça devrait marcher. De toute façon, c'est moi la créatrice, c'est moi qui ai fait cet univers-là. Donc je vais marquer, Elikia va passer par là, par ça et ça et ça, et elle va réagir comme ça. Et en fait, ça sonne faux. Et quand vous avez un personnage qui y a sa propre direction et qui vous force à changer la trajectoire de l'histoire, pour moi, vous avez créé une personne. Parce que c'est comme quand vous dites à quelqu'un, mais je pense que tu devrais faire ça, il vous dit non, moi, ce qui me correspond, c'est ça. Là, je me dis qu'en fait, on tient une personne plus qu'un personnage. Donc je crois que c'est là où aussi réside l'empathie.
Lia Warsa. Aussi, comme on l'a parlé à tout à l'heure, la solidarité qu'il y a dans le récit en fait, de voir tout la vie des autres personnages, de voir la réaction qu'ils ont les uns aux autres. En fait, on est vraiment liés à eux parce qu'on voit quel impact ils ont sur les autres en fait. Du coup, on est vraiment empathiques, on est dans leur histoire.
Laura Nsafou. C'est vrai que ça m'a surpris d'avoir autant de... Quand la trilogie s'est finie, là où, je pense, comme beaucoup d'auteurices, on est plus soucieux de se dire est-ce que j'ai fait une bonne fin. Quand ça s'est fini, les premiers retours que j'ai eu, c'est... Ah, en fait, ils vont plus être là. Ça m'a un peu surpris parce qu'il y a des personnes qui me disaient mais je suis en deuil, est-ce que c'était sûr qu'il n'y a pas une suite ou un petit chapitre supplémentaire pour qu'on reste un peu plus longtemps avec eux. Donc il y avait un peu avec cette idée que la communauté était tellement présente que cette empathie-là, en fait, elle restait même quand on fermait le livre. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'en tant qu'auteurice, on peut le planifier. Mais nous, on les suit, en fait.
Public. Je voulais vous poser une question parce qu'on utilise souvent les outils de Bechdel pour les personnages féminins, mais est-ce qu'on a des équivalents pour des personnes racisées ou pour des minorités de genre aussi ?
Laura Nsafou. On utilise quoi ? Vous avez dit, pardon ? Ah, bonne question. Oui, alors quelqu'un au fond me dit que oui, parlez-vous après, changez vos ressources. Moi, je n'en utilise pas, mais je pense qu'il y en a... Oui, parce que, ne sois-ce que côté anglophone, il y a beaucoup de ressources aussi de ce type-là. Après, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en français. Moi, je n'en ai pas utilisé. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est plutôt de comprendre une tradition littéraire noire, et surtout autour des femmes noires. Un exemple très bête. Toute la génération de Toni Morrison, Alice Walker, Maryse Condé, Simon Schwarzbart, il y a quelque chose qui revient beaucoup sur les femmes noires qui refusent d'avoir des enfants et qui veulent vivre pour elles-mêmes. Il y a un truc par rapport à cette génération-là qui est très présent. Il y a plein de super thèses, mémoires dessus. C'est passionnant, mais du coup, c'est des traditions. Et en fait, juste avant, donc Zora Nillerstone, etc., c'est encore autre chose. Et donc voir, en fait, les différents... C'est pas des schémas, mais presque les différentes périodes d'un canon littéraire, ça m'a beaucoup aidé à savoir ce que je voulais faire aujourd'hui en termes de personnages, etc., etc. Et je trouve que ça permet d'avoir une bibliothèque du coup d'écriture de personnages noirs. Et on y revient encore, même si je détestais lire petite, donc je ne suis pas dans la sacralisation de... Il faut adorer lire pour écrire. Moi, j'ai écrit plus que je n'ai lu. Mais le fait de lire et surtout de comprendre ce qui m'intéressait en termes de littérature, ça m'a permis d'avoir cette bibliothèque-là. Ça constitue une banque de données. Et en fait, plus on lit, en tant que lecteur ou lectrice, plus aussi on exerce son œil en tant qu'artiste. En fait, si déjà tu lis un bouquin en te disant, je me demande comment écrire des personnages noirs et que tu lis plusieurs bouquins. Ton œil, au fur et à mesure, va repérer tout seul la manière dont les personnages noirs sont décrits. Et même sans que tu notes, va commencer à se faire une petite bibliothèque de manière de décrire. C'est pour ça que je parle de pratique. Je pense vraiment à cette manière de pratiquer, d'être en relation avec différentes cultures, différentes traditions artistiques autour de la représentation des personnages noirs. Je crois aussi à l'approche pluridisciplinaire. Par exemple, la série Arcane, dans la représentation des personnages noirs, elle est incroyable, elle est incroyable. Peut-être pas en termes de personne... Enfin, l'écriture des personnages est à débattre, mais le design, la manière dont les nuances de peau sont représentées, les effets de brillance, etc., c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et la question, du coup, face à une œuvre visuelle, c'est comment tu retranscrire ça à l'écrit. Ça, c'était tout de suite un exercice d'écriture. Je m'arrêtais là, parce qu'on va pas lancer un atelier d'écriture maintenant, mais super question. Donc je pense qu'il y a plein d'autres points d'entrée, en fait.
Lia Warsa. Le test Bechdel, l'avantage, c'est qu'il est simple, il est très facilement adaptable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un test en trois règles. Est-ce qu'il y a deux personnages féminins ? Est-ce qu'ils ont chacun un nom ? Est-ce qu'ils se parlent, et spécifiquement, d'autres choses qu'un homme ? Du coup, en fait, c'est facile de l'adapter, parce qu'il suffit de partir du principe, est-ce qu'on a deux personnages noirs ? Est-ce qu'ils ont tous les deux un nom ? Est-ce qu'ils se parlent d'autres choses que deux personnes blanches ? Et tu as adapté ton test ?
Laura Nsafou. Est-ce qu'ils meurent au début ?
Lia Warsa. Oui, aussi très important, celle-là.
Laura Nsafou. Ça, pour moi, c'est la question même numéro... Ah, est-ce qu'ils meurent au début ? Il y en a plein. Est-ce que, déjà, on parle de... Oui, est-ce qu'il est drôle ? Est-ce que c'est un ressort humoristique ? Ou est-ce que c'est une personne ? Est-ce qu'il a une personnalité ? Il y en a plein. En fait, il faut qu'on le fasse.
Public. Merci. Je vous écoute et je trouve que vous n'êtes pas vindicatif par rapport au blanc et ça me fait plaisir parce que dans la salle il y a quand même beaucoup de blancs. Je trouve ça un problème important par rapport toujours cette histoire du colonialisme que moi j'ai pas ressenti quand j'étais jeune, j'avais des amis noir mais je ne me rendais pas compte qu'on ne se faisait pas le problème. Alors que je vois maintenant, c'est un problème qui est ardu. Enfin, ça revient souvent, quoi.
Laura Nsafou. Je pense que c'était déjà là avant. Je pense qu'il y a l'expérience personnelle et l'expérience collective. Et là, aujourd'hui, on arrive à un stade aussi où il y a une mémoire où, si aujourd'hui, Haïti paye toujours une dette coloniale, pour eux, c'est encore leur présent. Par exemple. Si aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réparation par rapport aux Antilles, qui sont plus facilement perçues comme des destinations touristiques que comme des citoyens victimes du chlerdémonne et manquant d'eau encore aujourd'hui en 2025. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a laissé pourrir aussi ? Je pense que c'est pour ça que ça revient. Enfin, ça revient. Je pense que ça a toujours été là en vrai. Mais je pense qu'en termes d'expérience collective, on peut avoir une impression de résurgence, entre guillemets, parce qu'il y a trop de choses qui se sont accumulées. Je pense.
Lia Warsa. Et parce qu'on a une ouverture à la parole qui est très différente aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont permis énormément de choses, mine de rien. Le fait qu'on ait des associations qui se soient créées, le fait qu'il y a eu énormément de débats qui ont été lancés au moment où il y a eu des collectifs, par exemple, les collectifs, Mawsi, qui a commencé à faire des événements en non-mixité non seulement en genrée, mais également raciale, et d'un coup, wow, c'est de la suite possible. Non, on a besoin de tout le monde pour parler.
Laura Nsafou. Et il y a aussi une réalité, comme pour l'image qu'on a du féminisme ou autre, c'est qu'il y a eu un effacement. C'est-à-dire, je prends juste l'exemple de mon père. Beaucoup de personnes noires, je vais juste dire noires, parce qu'après, il y a aussi d'autres strates en termes de marginalisation. Mais mon père a voulu faire un mémoire, ou un doctorat en tout cas, sur les questions de colonialisme. On lui a volé sa thèse. Il y a énormément de travaux de personnes issues de ces peuples colonisés qui voulaient apporter cette conversation sur la table, qui ont été silenciés, effacés, volés, détournés depuis des décennies, qu'ils n'avaient pas de blog à ouvrir pour dire, en fait, j'ai fait ça. Dès lors qu'ils n'étaient pas dans des canaux de diffusion académique ou même qu'ils n'avaient pas accès à la presse, en fait, cette parole était là, mais on ne pouvait pas l'entendre. Donc je pense que c'est ça, c'est qu'on a, comme tu l'as très bien dit, j'ai vraiment oublié, on a eu les réseaux sociaux qui ont permis cette mise en avant de ces conversations-là, qui étaient déjà présentes pour moi, par exemple, quand j'étais petite dans le salon de mes parents, par exemple. Et je suis aussi de cette génération-là. Donc je ne pense même pas que la carrière que j'ai eue aujourd'hui, je ne l'aurais pas eu sans les réseaux sociaux, où j'ai pu adresser les questions d'afrofeminisme et de représentation, etc. Et même comme ça, même par ce biais, ça a été extrêmement violent et difficile.
Public. Bonsoir, merci. Je reviens sur un sujet qui a été abordé au tout début sur les questions des divinités des différentes sociétés africaines. Je suis un petit peu étonné qu'il n'y ait pas de travaux universitaires sur tout un continent.
Laura Nsafou. Alors, c'est la grosse question. Ah, j'étais quand même fou. C'est-à-dire qu'il y a des travaux universitaires faits par des chercheurs africains, mais extrêmement, extrêmement, et j'espère que ça a changé parce que quand j'ai commencé ce travail, c'était il y a six ans, mais extrêmement difficile d'accès. On parle d'un PDF trouvé à 2h du matin, quelque part dans les méandres de Google. Donc ils existent, mais ils sont extrêmement difficiles d'accès. Et qu'est-ce qui est plus facile à trouver ? Ce sont les textes anthropologiques de missionnaires dans les années 1700 qui vont vous dire, ah, je crois qu'ils prient cette divinité qui s'appelle Sénégal. Sénégal, ça veut dire la barque, la pirogue, et c'est devenu le nom d'un pays. Donc en fait, déjà, c'est extrêmement compliqué, non seulement d'avoir des ressources directes des personnes concernées, et aussi qu'elles soient accessibles. Donc moi, j'adorerais justement... Après, je pense que là encore, il faut resituer, si j'avais fait mes recherches depuis un pays d'Afrique francophone, j'aurais peut-être eu plus de facilité. Il y a aussi un deuxième point qui est la culture du secret aussi. On parle de divinités qui étaient très, qui sont encore aujourd'hui dans une traduction orale, dans une tradition du secret, qui n'a pas forcément vocation aussi à être diffusée comme ça partout. Donc ça fait beaucoup d'embûche. Et c'est aussi pour ça, connaissance et d'embûche-là, que je précise toujours que nos jours brûlés, c'est inspiré de ces divinités-là. Donc mon panthéon, il est créé, mais à la fin du bouquin, il y a toutes les divinités dont je me suis inspirée, pour que si on veut aller plus loin et connaître les vraies divinités qui sont encore priées aujourd'hui, qu'on puisse en fait avoir... Comment dire ? Oui, avoir une base. Et il y a aussi des rapports de force en termes d'édition. C'est-à-dire que quand je suis allé au Brésil, il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes d'anthologie sur non seulement la mythologie des orichas, mais aussi d'Afrique de l'Ouest. Il y avait énormément de choses. Sauf que la littérature portugaise n'intéresse pas le marché anglais, n'intéresse pas le marché francophone ou très peu. Donc en fait, quand vous arrivez au Brésil, vous voyez plein de références et vous y avez pas accès. Et pareil, les productions publiées en Afrique francophone ne sont pas dans nos Fnac. Très souvent, ce qu'on a, c'est l'auteur africain primé dans tel pays d'Occident, qui ensuite va être axé. Donc quand il y a vraiment des rapports d'accès qui ont extrêmement difficile ces sources-là, j'aurais aimé faire un séjour de recherche sur place. Ça aurait été génial. Mais il aurait fallu se choisir quel pays, quelle université, quelle ressource. Et puis aussi, comme je le disais, je suis française. Donc même si je suis allé voir mes oncles, les tentes congolaises pour savoir ce qu'on avait raconté quand ils étaient petits, etc., quand je me suis rendue au Sénéral, on me disait, oh, laisse ces choses-là, laisse, laisse, c'est pas, c'est pas, voilà, il y avait quand même ce truc de, c'est un savoir qui nous est propre. Et ça aussi, ça demande aussi une relation de confiance en termes de diffusion. Donc il y a plein, voilà, pour toutes ces raisons. Ouais, j'attends. Mais peut-être qu'on va voir cette encyclopédie émergée.
Public. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez raconté et puis aussi pour votre blog que j'ai découvert récemment. Alors moi, ma question va plutôt porter sur le domaine de la fantaisie, je ne sais pas si vous êtes aussi spécialiste de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'auteurices qui mettent en avant des personnages racisés. Mais, enfin, qu'est-ce que vous pensez de la réception du public ? En un moment, je sais que vous parlez de whitewashing dans votre blog. Moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup et qui m'affecte beaucoup malgré les efforts faits par les auteurices blancs et blanches. Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Laura Nsafou. Tellement de choses à dire. Alors je pense que déjà, il y a plusieurs choses. C'est que même dans la proposition littéraire qu'on a avec des personnages racisés, déjà écrits par des personnages concernés, très souvent c'est anglophone. Donc déjà, comme on me dit, c'est super, Laura, maintenant il y a beaucoup plus de livres avec des personnages noirs. Très souvent, c'est des traductions de titre américain. Et encore, j'aimerais que ce soit d'autres pays anglophones, mais ce n’est souvent pas le cas. Donc déjà, pour moi, il y a une espèce de part avant qui donne une impression de diversité, qui est quand même un monopole littéraire très fort. Ensuite, l'autre strate, oui, en fait, c'est devenu déjà d'un point de vue statistique. Après la mort de George Floyd, il y a eu un intérêt de toute l'édition américaine pour les questions de diversité et particulièrement des personnes marginalisées en littérature, young adulte, dans tous les domaines confondus, jeunesse. Donc il y a eu des commandes jetées comme ça aux États-Unis sur « On veut publier des livres avec des personnages marginalisés ». Super, vous allez me dire, sauf que ce qui est arrivé, pour certains auteurs, ça a permis de lancer des carrières. Je pense à The Hate U Give (Angie Thomas), enfin voilà, d'autres livres, mais il y a eu aussi cet effet de mode. Et c'est sourcé, il y a les chiffres. Deux ans plus tard, c'est très macabre, mais deux ans plus tard, après la mort de George Floyd, ça a disparu cette tendance. Et là, en fait, ce qu'on a, c'est des petites tentatives de continuer à... En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on a une instrumentalisation du corps des personnages racisés de plus en plus, parfois, aussi, qui sont juste sur les couvertures, mais pas dans le bouquin, ça aussi, je l'ai beaucoup vu en jeunesse. Donc il y a, pour moi, on arrive à ce truc où j'appelle le lectorat quand il regarde un bouquin qui dit « Oh, c'est génial, il y a de la représentation, de savoir qui est derrière, quels sont les intentions aussi du livre ». Mais après, il y a un problème sur le fait de concevoir juste les personnages marginalisés comme sujet. Si on les conçoit comme des personnages, on ne devrait pas sentir cette espèce de tentative ou d'efforts de les mettre au chausse-pied dans une histoire. En fait, si vous voulez considérer comme des personnes, ça ne devrait pas poser problème. Et je pense que c'est ça, comme ça a été cette espèce de tendance de « il faut en mettre », même si on ne sait pas trop comment, mais du moment qu'on en met un et qu'il a la peau basanée, ça passe, ça a été mal fait. Et aussi, parce qu'il y a cette peur d'avoir cette conversation, c'est-à-dire que ça s'apprend, ça s'apprend qu'on vit dans une société raciste qui nous a donné depuis qu'on est petits un imaginaire colonial, en fait, on l'a ingéré et donc pour désapprendre ça, ça s'apprend, il faut s'asseoir, il faut venir dans nos ateliers, on n'a pas envie de venir, il faut être mal à l'aise, oui, on va dire les mots blancs, noir, on va être mal à l'aise, mais en fait, si on n'a pas de conversation, on ne peut pas faire un travail de fond. Et le dernier point, et après je me tais parce que je sais qu'on va me chasser d'ici.
Lia Warsa. C'est pas vrai que tu vas signer des livres après.
Laura Nsafou. Je suis désolée, mais le dernier point qui pour moi est fondamental, c'est qui est dans la maison d'édition ? Prendre seulement des personnes marginalisées pour écrire, ça ne suffit pas. Si on a eu en effet post-George Floyd, et déjà, je trouve ça dramatique, qu'il est fallu le meurtre de cet homme pour que ce soit une conversation, et je parle du marché américain, mais parce que le marché américain mène aussi les tendances qu'on peut voir aussi internationales, pour que ce soit quelque chose de permanent, il faut que les équipes dans les maisons d'édition soient toutes aussi diversifiées, que ce soit en comm, que ce soit dans les équipes éditoriales, que ce soit dans les directions d'édition, que ce soit dans les services de fabrication, et ce n'est pas le cas. Et ça, en fait, tant qu'on n'a pas ça, et ça, on parle de personnes marginalisées, mais c'est tous les groupes marginalisés. Quand vous avez une autrice, Elisa Rojas, qui me disait donc une autrice qui est en situation d'handicap dans un fauteuil roulant qui me dit qu'un éditeur lui a dit que je ne me reconnais pas dans votre histoire qui parle de vous, et donc je ne vais pas vous publier, qu'on vient d'histoires n'ont pas accès à nous, parce qu'on a un petit groupe d'éditions qui dit que je ne me reconnais pas, en fait, dans votre histoire. Je pensais que tout ça veut dire que tous les corps, toutes les personnes ne sont pas universelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, beaucoup de travail. Mais ça avance. Donc, comment on fait plier ça ? C'est les lecteurs qui font plier ça. On l'oublie souvent, le monde de l'édition, c'est parce qu'un éditeur pose un livre, et voici, ça se vend, que pendant les dix prochaines années, vous allez avoir plein de livres sur les sorciers, les vampires, etc. C'est vous qui faites plier ça. Sinon, en fait, il n'y a pas de... Si on compte, si le peu de titres qui sont considérés comme des risques, comme un afrofuturisme en France, etc., ne marche pas, on n'aura plus ça, en fait. Moi, j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. Non, j'ai juste proposé quelque chose, et les lecteurs ont dit, en fait, ça nous intéresse, et c'est ça qui peut amener à une vraie diversité.
Lia Warsa. Merci. Merci à tous d'être venus ce soir.
Laura Nsafou. Merci pour vos questions. Merci pour tes questions.
Lia Warsa. Merci, Laura. Et n'hésitez pas à nous retrouver dès demain matin, dix heures pour la cérémonie d'ouverture du festival Ouest Hurlant à La Paillette.
Laura Nsafou. Merci beaucoup.